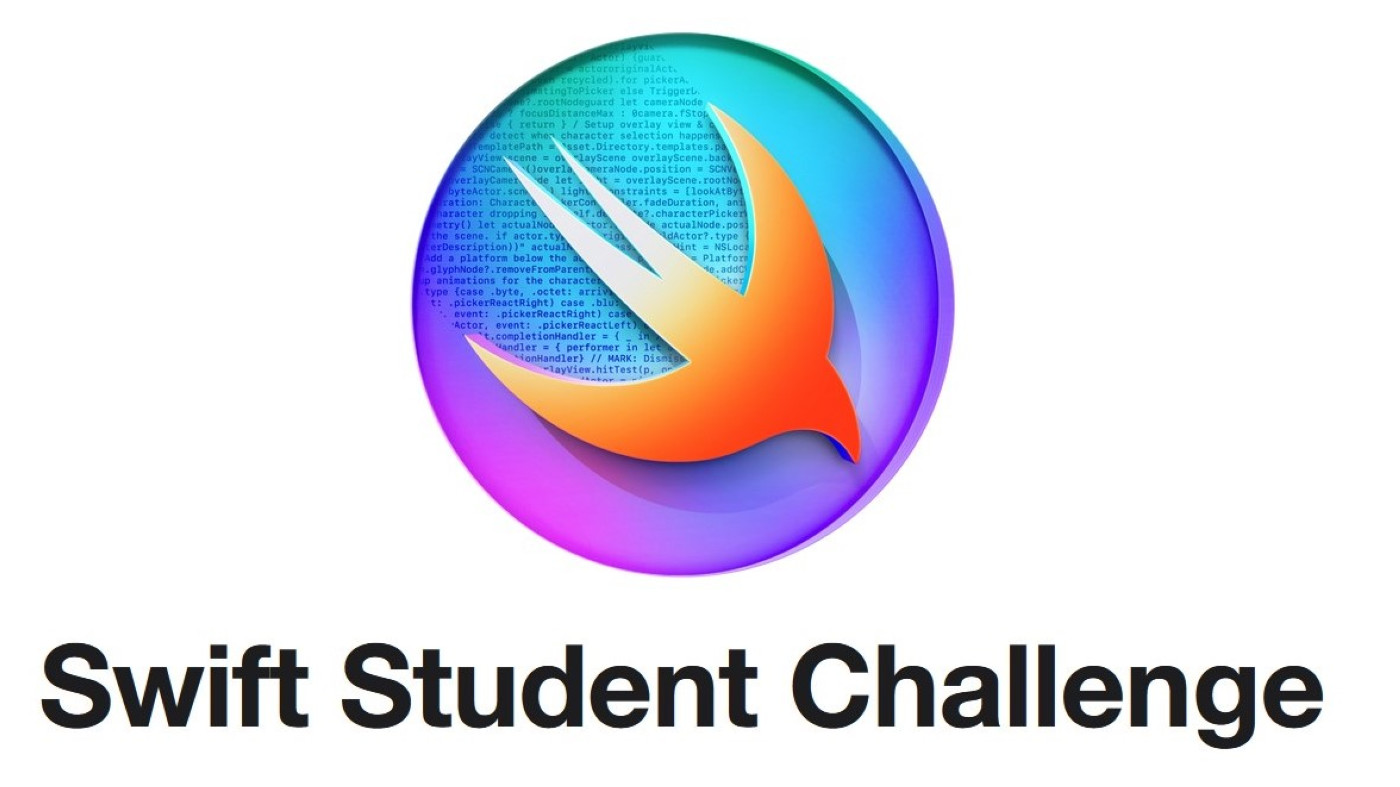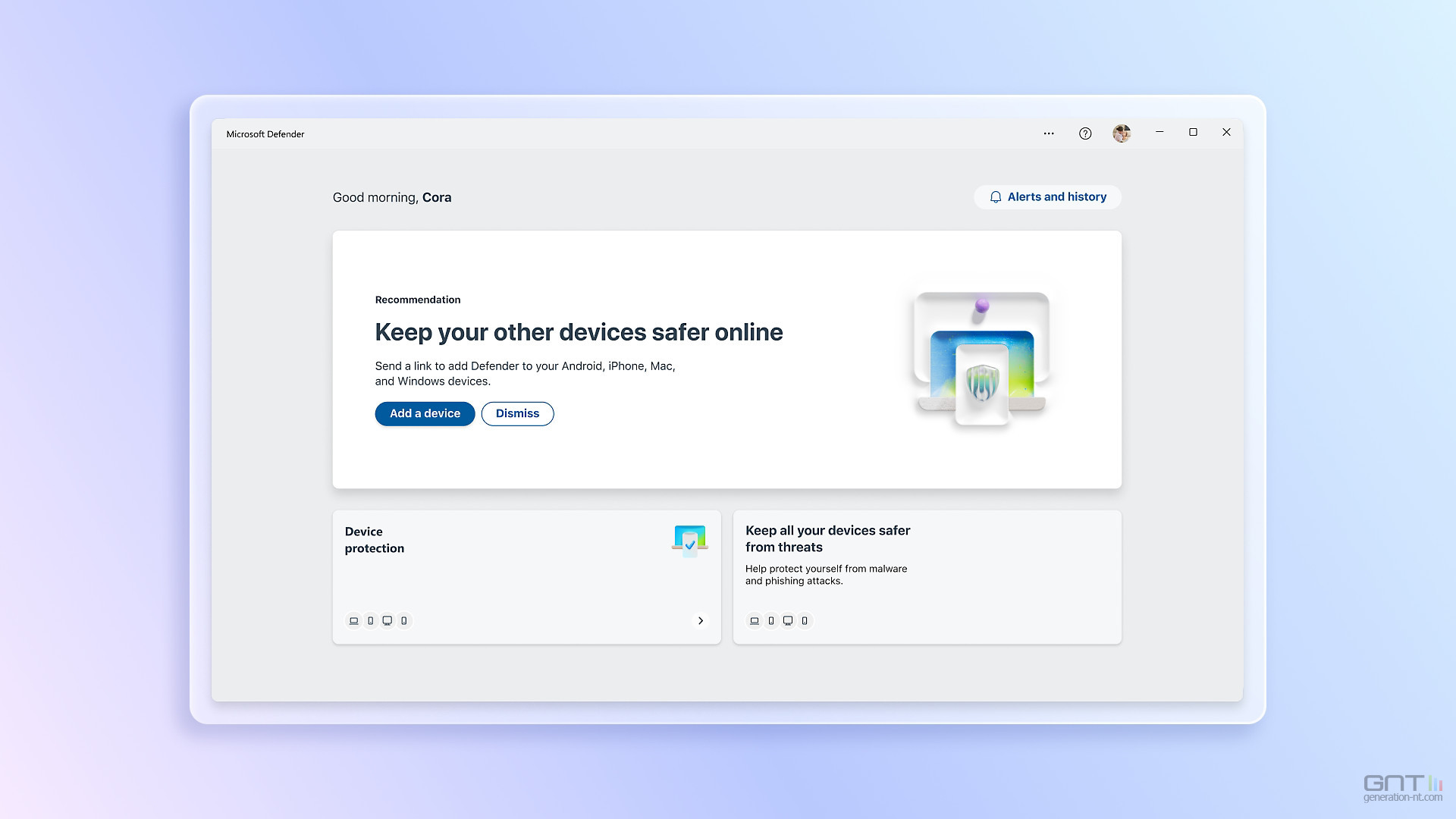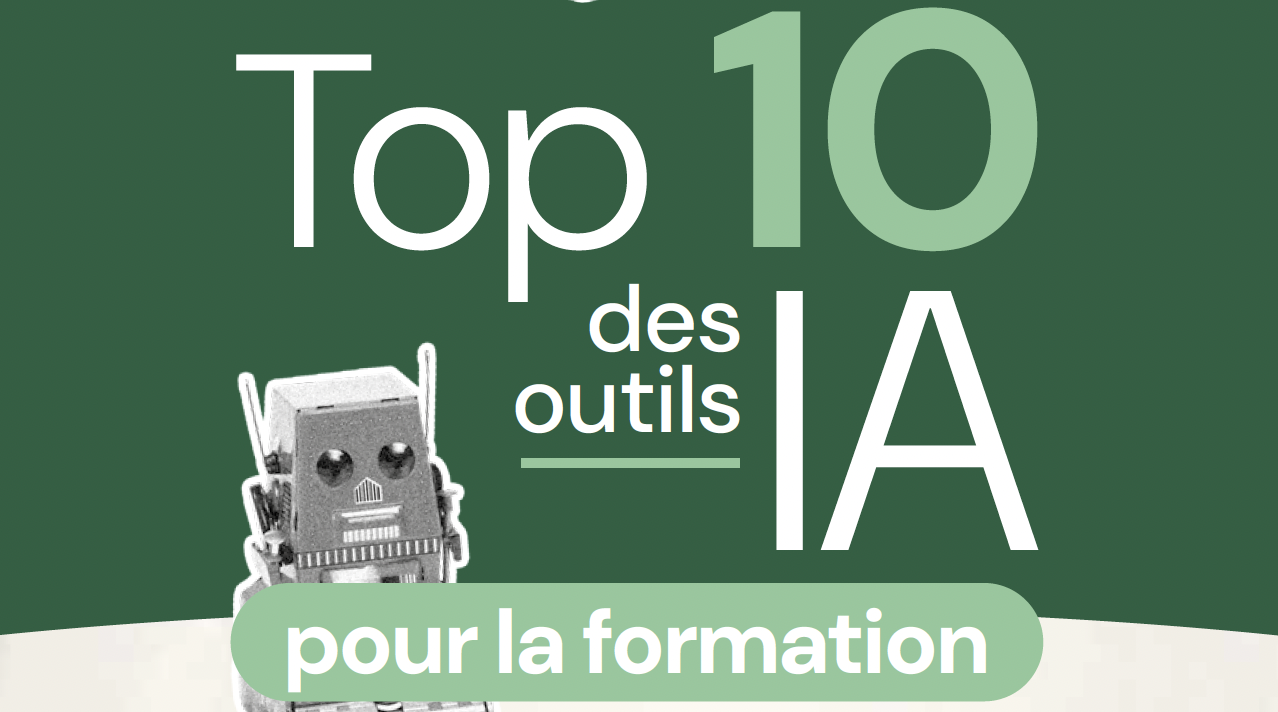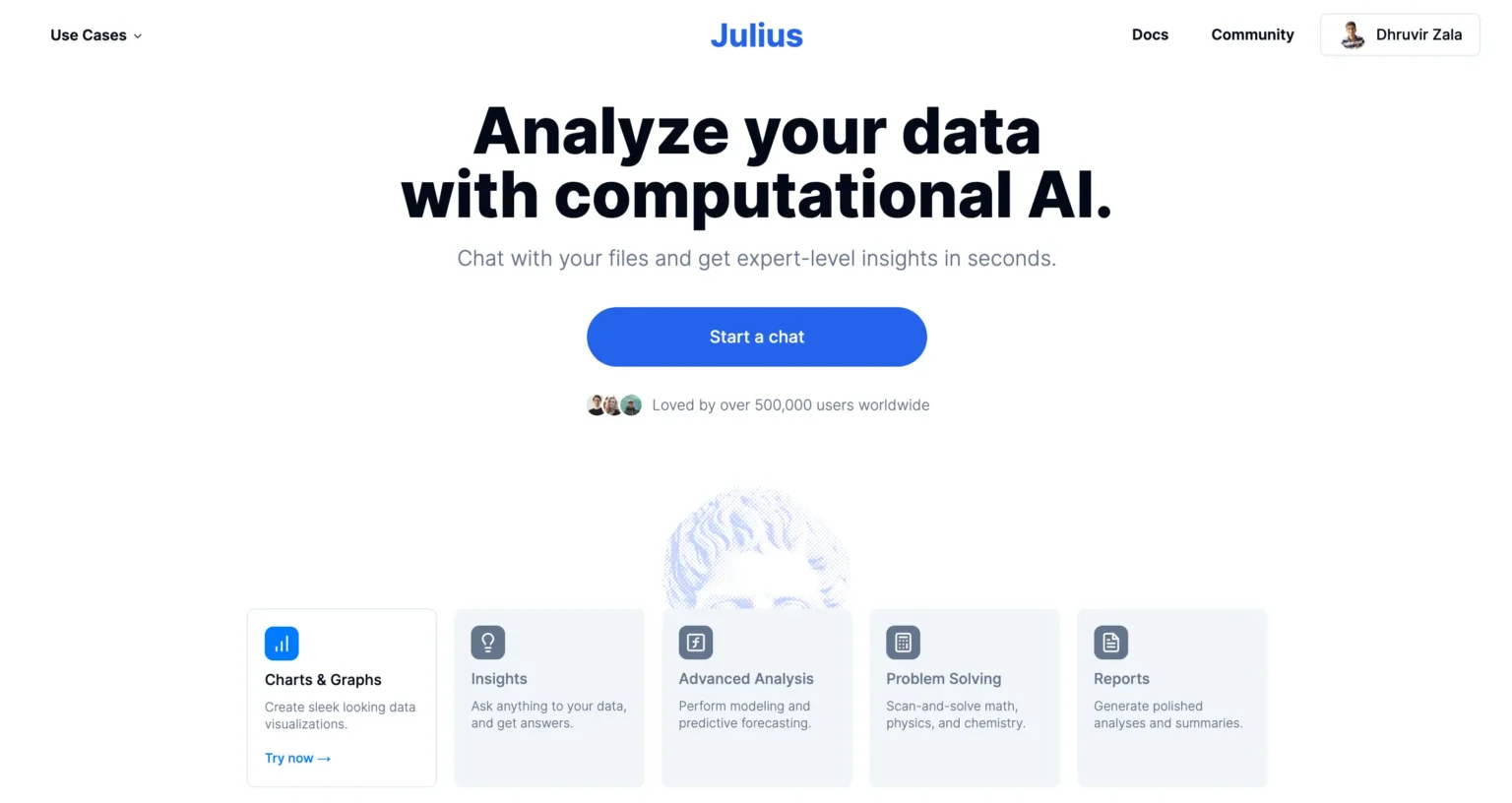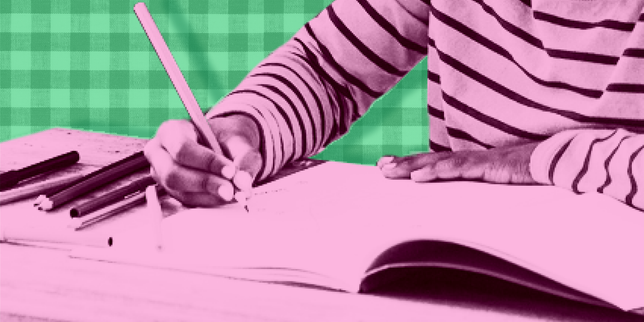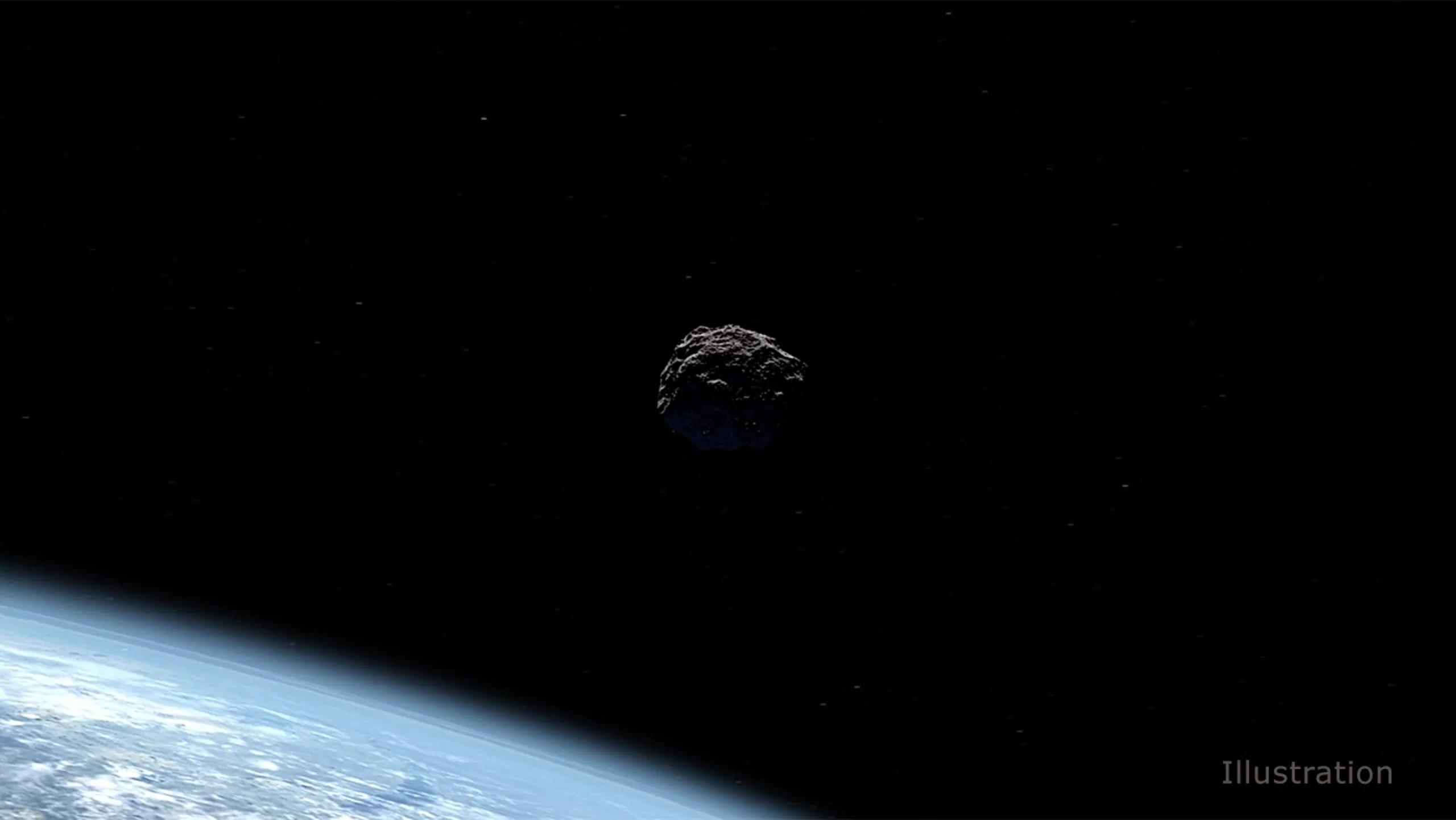Salaires des enseignants : le grand déclassement ?
Dans l’OCDE, la France est le pays où le salaire des enseignants, rapporté à leur niveau d’études, est parmi les moins avantageux.

Dans les métiers enseignants, le nombre de candidats aux concours est en baisse tandis que les démissions connaissent une hausse tendancielle. Le temps où ces métiers étaient investis comme un sacerdoce semble révolu. Comment expliquer cette désaffection ?
Coordonné par la sociologue Géraldine Farges et le politiste Igor Martinache, l’ouvrage Enseignants : le grand déclassement ? (PUF, 2025) se penche sur les facteurs et les effets de cette érosion, des politiques de recrutement à l’exercice quotidien du métier d’enseignant.
Extrait du premier chapitre, consacré à l’affaiblissement social des enseignants, sur l’évolution des rémunérations. Nous avons respecté ici le choix fait par l’éditeur PUF de l’utilisation du point médian pour féminiser les noms de métiers en particulier.
Le constat de la faiblesse des niveaux de salaires des enseignant·e·s est aussi ancien que récurrent. Par exemple, au milieu des années 1980, Jean-Michel Chapoulie considérait que les rémunérations des professeur·e·s du secondaire semblaient « presque toujours avoir été médiocres et inférieures en moyenne à celles des diplômés d’enseignement supérieur employés dans d’autres secteurs d’activités ».
Depuis les années 2000, le même constat est fait à plus large échelle lors de la publication des données comparatives de l’OCDE, qui montrent que les salaires des enseignant·e·s sont bas par rapport à ceux des diplômé·e·s de même niveau en France – ce qui est globalement le cas dans la plupart des pays de l’OCDE mais à différents degrés, les enseignant·e·s en France font partie de celles et ceux dont le salaire rapporté au niveau d’études est parmi les moins avantageux. En outre, s’il est faible, le salaire enseignant en France est aussi marqué par une tendance à la baisse, mise en évidence par les analyses comparatives sur trois décennies des salaires et primes des corps enseignants français de Bernard Schwengler.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Depuis les années 1980, la valeur du point d’indice n’a cessé de diminuer tandis que les contributions sociales prélevées sur les salaires se sont, elles, élevées et, dans un contexte de rationalisation de l’action publique, les appels aux réductions budgétaires empêchent toute hausse significative des traitements et des primes des enseignant·e·s. En outre, l’auteur insiste sur la part réduite qu’occupent les primes et indemnités diverses dans la rémunération des enseignant·e·s, ce qui explique que les inégalités de revenus se soient creusées entre les enseignant·e·s et d’autres fonctionnaires de catégorie A.
Dans le même temps, le niveau d’études moyen des enseignant·e·s n’a lui cessé de s’élever en France. Comme le salaire, le niveau d’études figure aussi parmi les indicateurs classiques du statut social d’une profession. Toujours aux États-Unis, de nombreux travaux ont ainsi été consacrés à la formation des enseignant·e·s, envisagée à la fois en termes de niveau à atteindre et contenus à acquérir et comme manière de « professionnaliser » les enseignant·e·s, ce qui, dans ce contexte, signifie tenter de leur faire acquérir le statut socialement enviable des « professionals », qui se caractérisent par la maîtrise de savoirs spécialisés de haut niveau. Dans ce pays, l’élévation du niveau d’études des enseignant·e·s a été le facteur le plus important dans l’amélioration de leur statut professionnel.
Observé au prisme de leur niveau d’études, le statut social des enseignant·e·s en France apparaît plutôt élevé : en comparaison internationale, leur niveau d’études, qui s’établit à cinq années d’études après le baccalauréat depuis la réforme dite de la « mastérisation » de 2008, est plus élevé que celui de la moyenne des pays de l’OCDE. Les deux indicateurs du statut social objectif que sont le salaire et le niveau d’études présentent donc des décalages, de sorte que les enseignant·e·s se révèlent difficiles à positionner dans l’espace social en France, à la fois proches des groupes professionnels les plus favorisés et valorisés d’une société par certaines de leurs ressources, comme le diplôme (on aurait aussi pu évoquer l’utilité sociale de leur métier), mais distants sur d’autres, en premier lieu le salaire (ou également leur marge plus incertaine d’autonomie).

Les décalages sont d’autant plus saillants que l’on s’éloigne des niveaux moyens pour considérer les dynamiques tracées par ces deux grandeurs, le salaire et le niveau d’études, selon les corps enseignants français. En France, « les mondes enseignants » sont différenciés et hiérarchisés, et les réformes récentes n’ont pas remis en question ces hiérarchies professionnelles. S’ils sont tous des fonctionnaires de catégorie A, les professeur·e·s des écoles, les professeur·e·s certifié·e·s, les professeur·e·s de lycée professionnel et les professeur·e·s agrégé·e·s (catégorisé·e·s cependant, à l’usage, dans une catégorie « A+ » par l’administration) sont loin de percevoir les mêmes salaires.
Bernard Schwengler montre que les mesures de revalorisation de carrière qui ont concerné les professeur·e·s des écoles et les professeur·e·s des lycées professionnels ont été synonymes d’une revalorisation salariale pour ces deux corps, stabilisée depuis 2000 mais réelle sur la période antérieure, quand les autres corps (les agrégé·e·s et les certifié·e·s en particulier) ont vu continûment leurs salaires baisser à échelon constant.
En outre, pour les enseignant·e·s du premier degré, l’établissement à « bac+3 » du niveau de diplôme requis lors du passage de l’institutorat au professorat des écoles à partir de 1990, a changé leur position dans la hiérarchie scolaire. En effet, la comparaison de l’âge de fin d’études initiales des individus en activité, à l’aide des séries de l’enquête « Emploi » de l’Insee, de plusieurs groupes professionnels, montre que les professeur·e·s des écoles sont le groupe professionnel qui, dans la société française, a connu le plus grand changement démographique en termes de niveau d’études entre les années 1980 et 2000.
Si l’âge de fin d’études s’est aussi élevé pour les ouvriers et ouvrières, les employé·e·s, les professions intermédiaires et les cadres, il s’est accru de plus d’une année chez les professeur·e·s des écoles : moins de deux années d’études séparaient les instituteurs et institutrices de la moyenne des actifs et actives occupé·e·s au début des années 1980, cet écart est de plus de trois ans depuis le début des années 2000.
Pour les « agrégé·e·s et certifié·e·s », la situation est toute autre : figurant historiquement parmi les groupes professionnels les plus diplômés dans la société française, ils et elles se voient au contraire « rattrapé·e·s » par plusieurs groupes professionnels du point de vue de leur niveau d’études.
Ainsi, revalorisé du point de vue du salaire et du niveau de diplôme, le statut social des enseignant·e·s du premier degré s’est objectivement inscrit dans une tendance à la hausse en France suivant ces deux indicateurs, quand celui des agrégé·e·s et des certifié·e·s est à la baisse en termes de salaire et stable en termes de qualification dans un contexte d’élévation générale du niveau de diplôme.
Cependant, gardons à l’esprit que le niveau d’études fait figure d’assise incertaine du statut social puisqu’il est régulièrement débattu. Sur ce point, la situation française, au début des années 2020, apparaît assez caractéristique : au plus haut niveau de l’État, les « diplômes excessifs » dans l’enseignement ont été dénoncés, de sorte que la non-remise en cause de la mastérisation a dû être défendue dans un contexte de réforme de la formation des enseignant·e·s et de volonté d’abaisser à « bac+3 » le diplôme minimal exigé pour se présenter aux concours de l’enseignement dans le premier et le second degré.![]()
Géraldine Farges ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

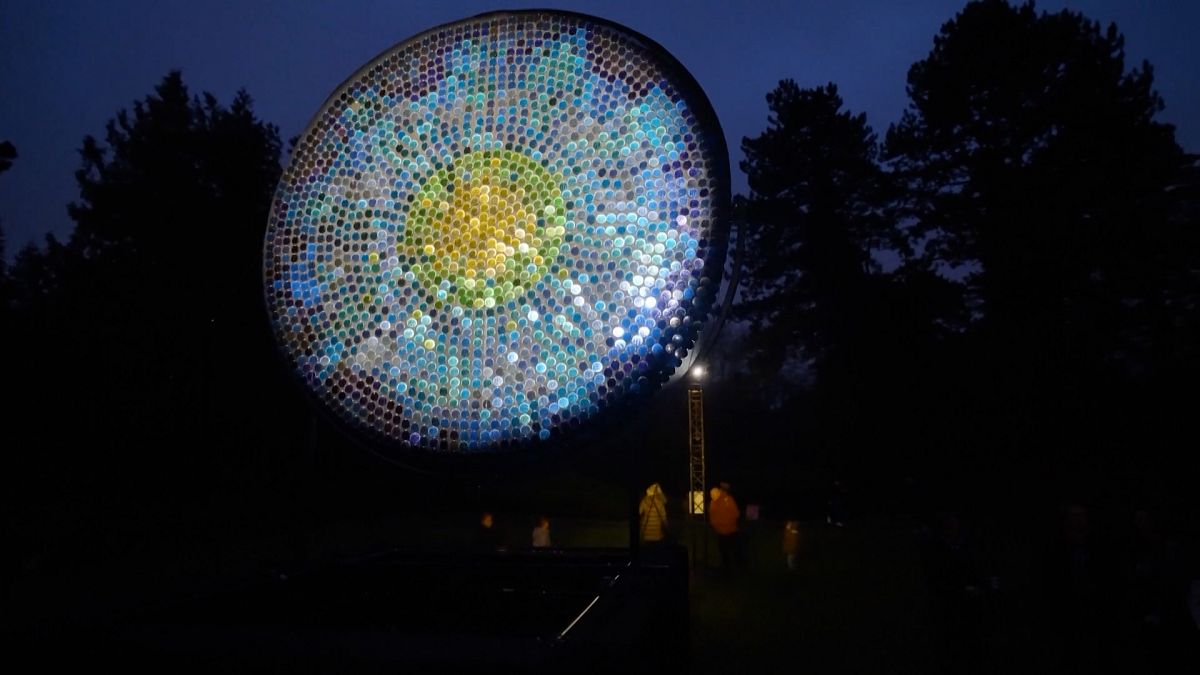
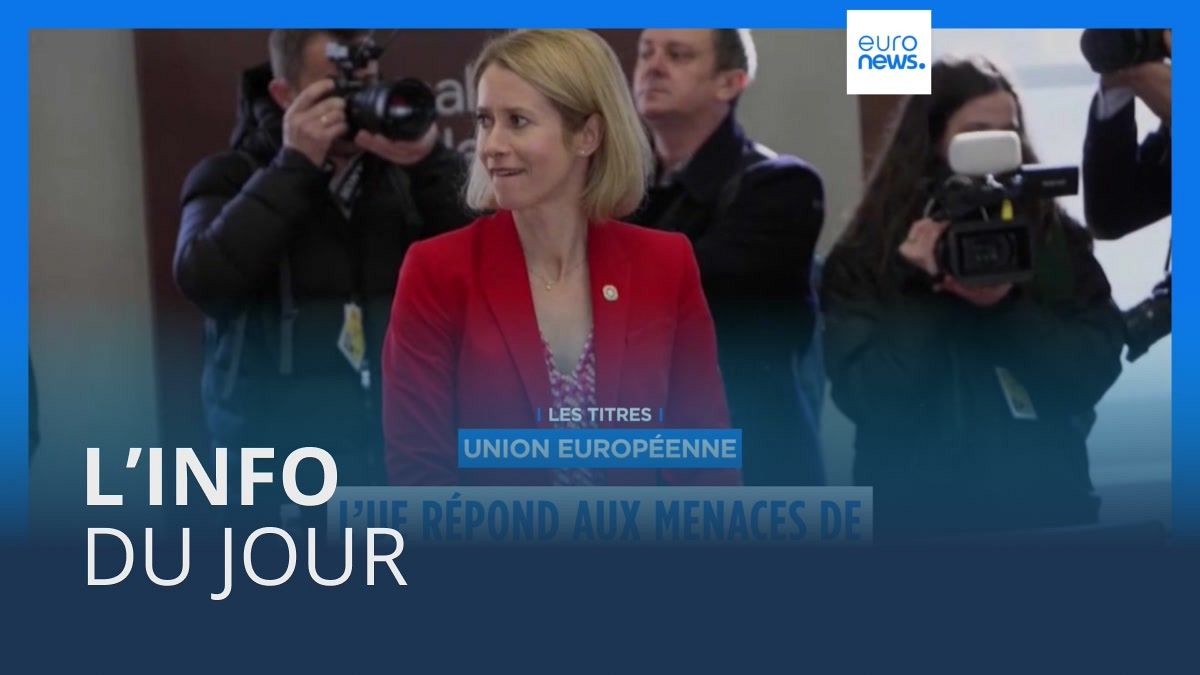
















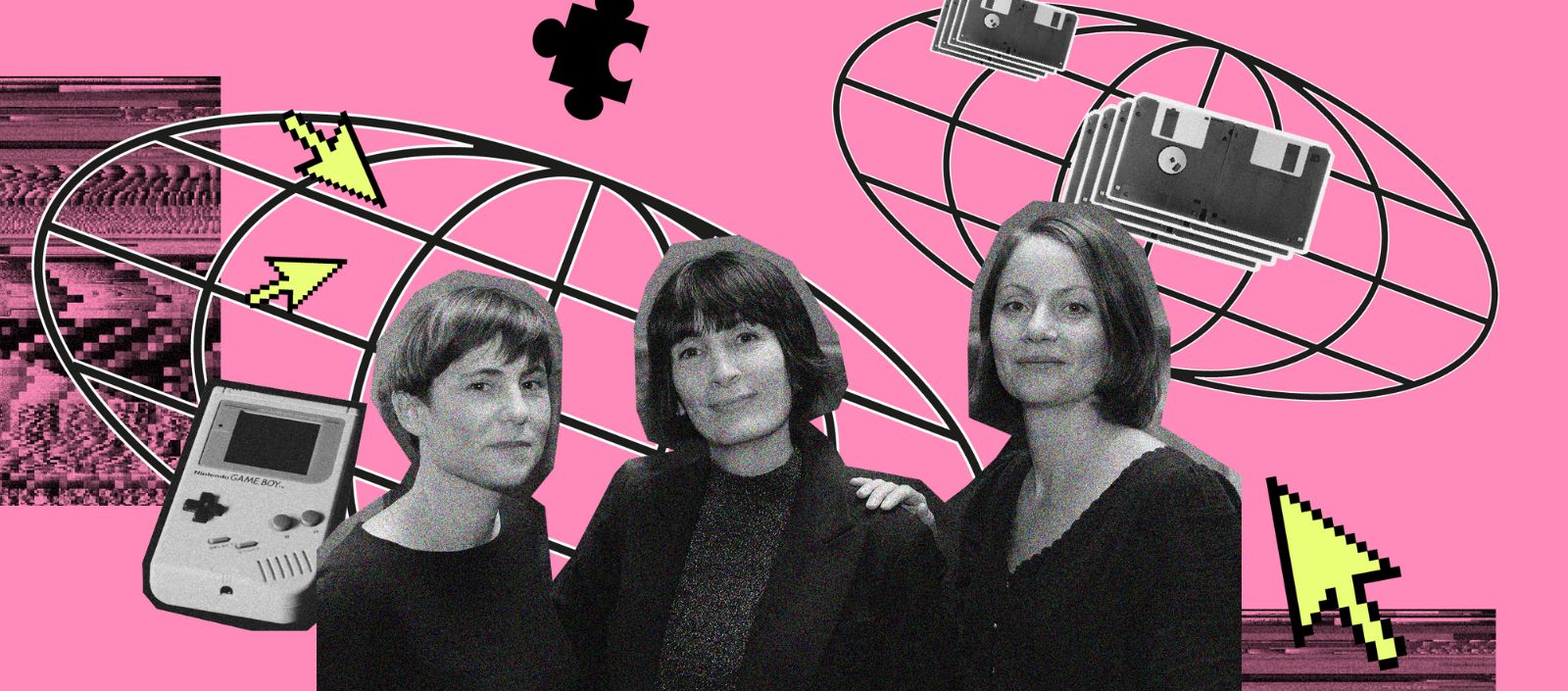
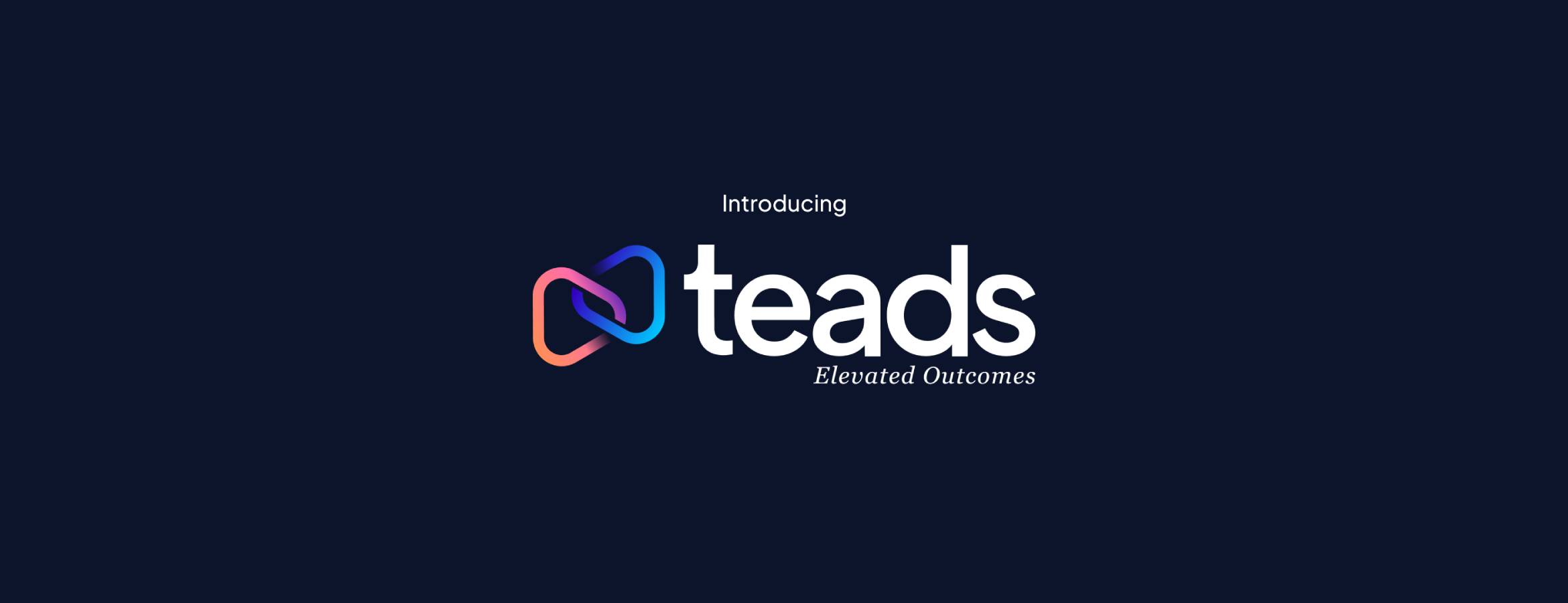
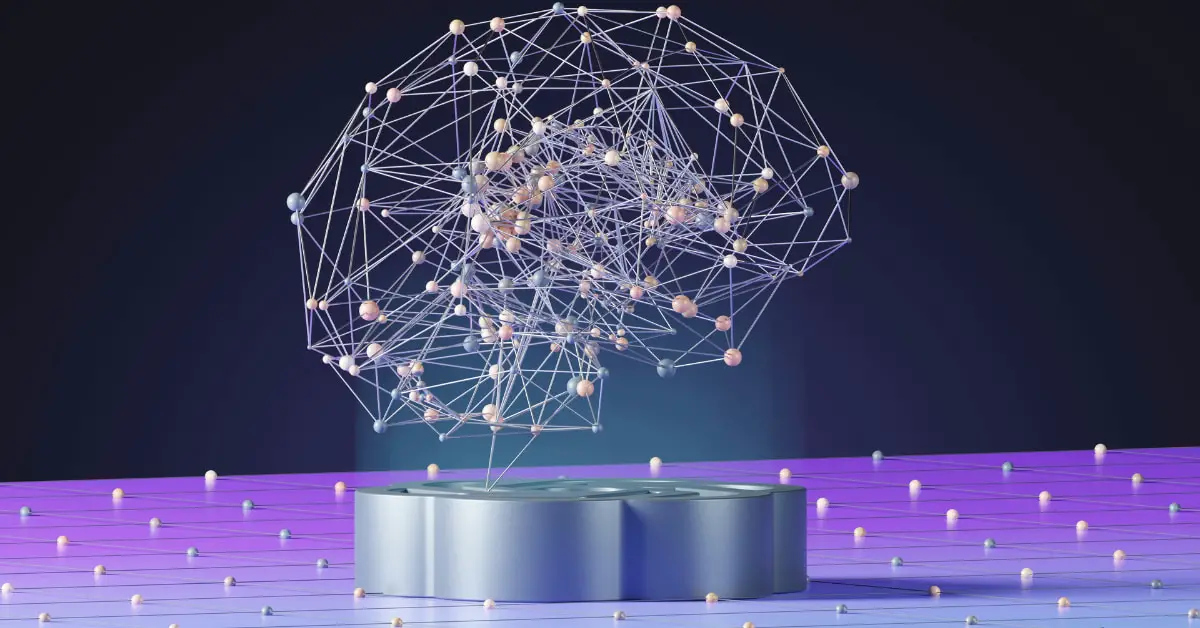






![[MàJ] Apple valide la première application porno sur iPhone](https://static.iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2025/02/Hot-Tub-Application-iPhone.jpg)