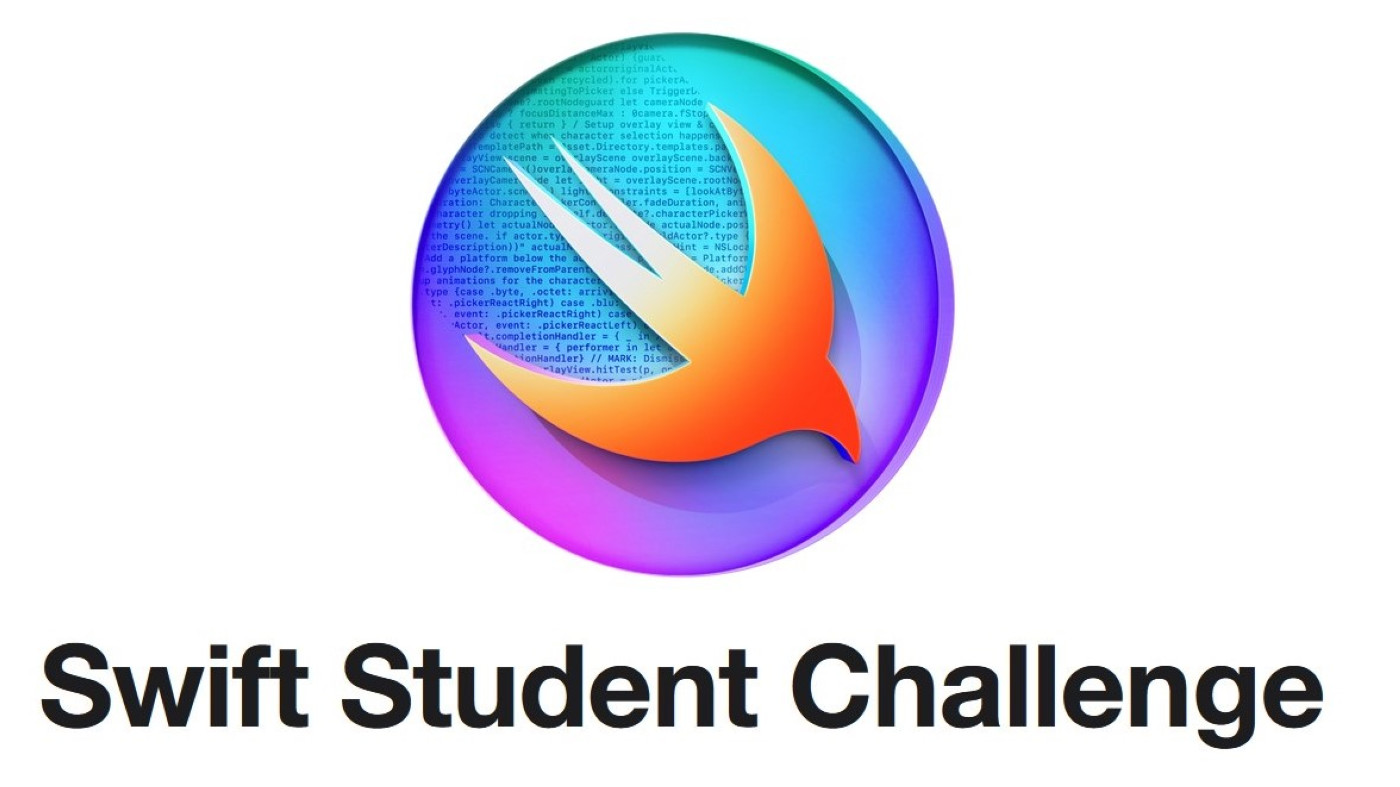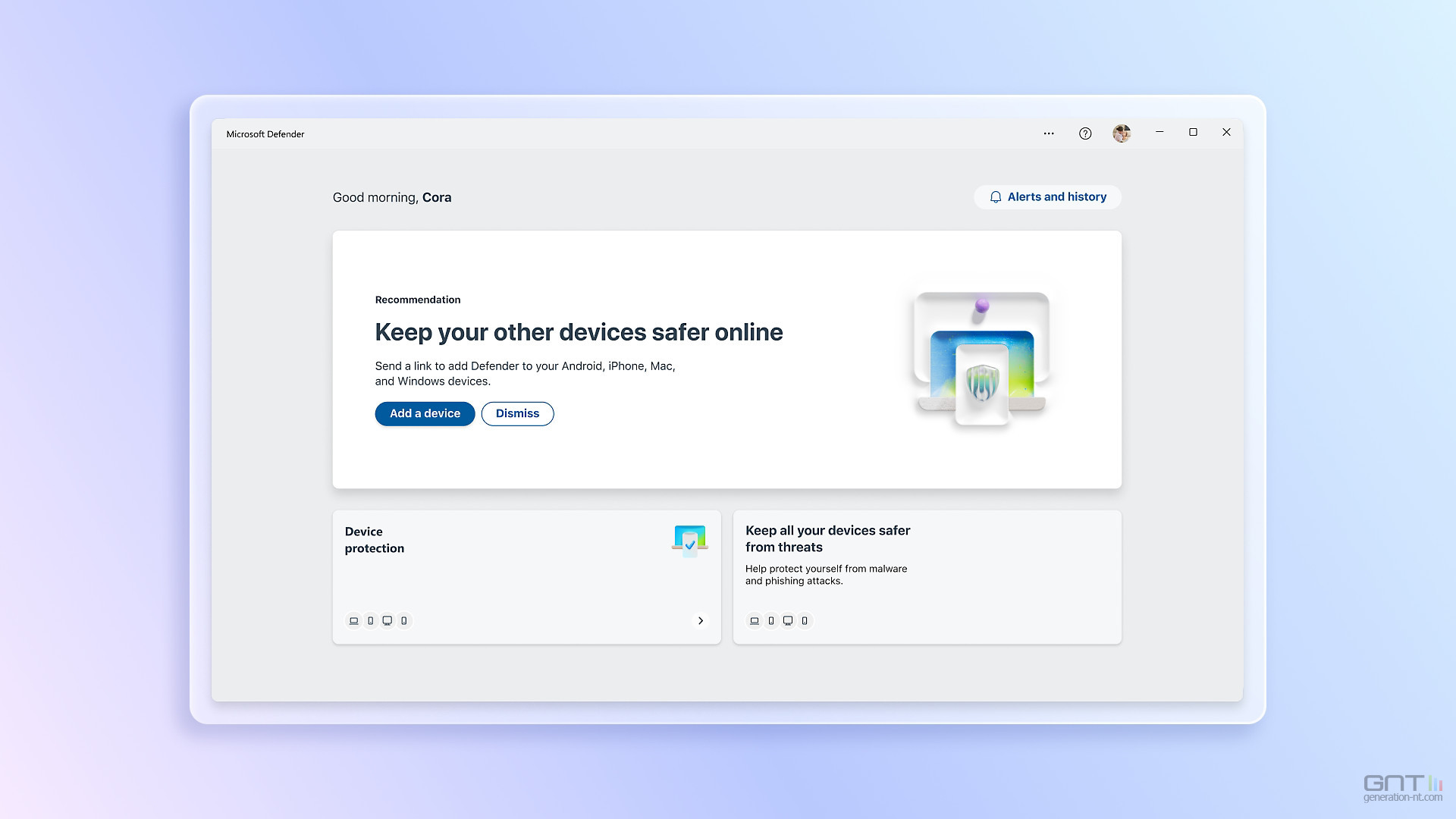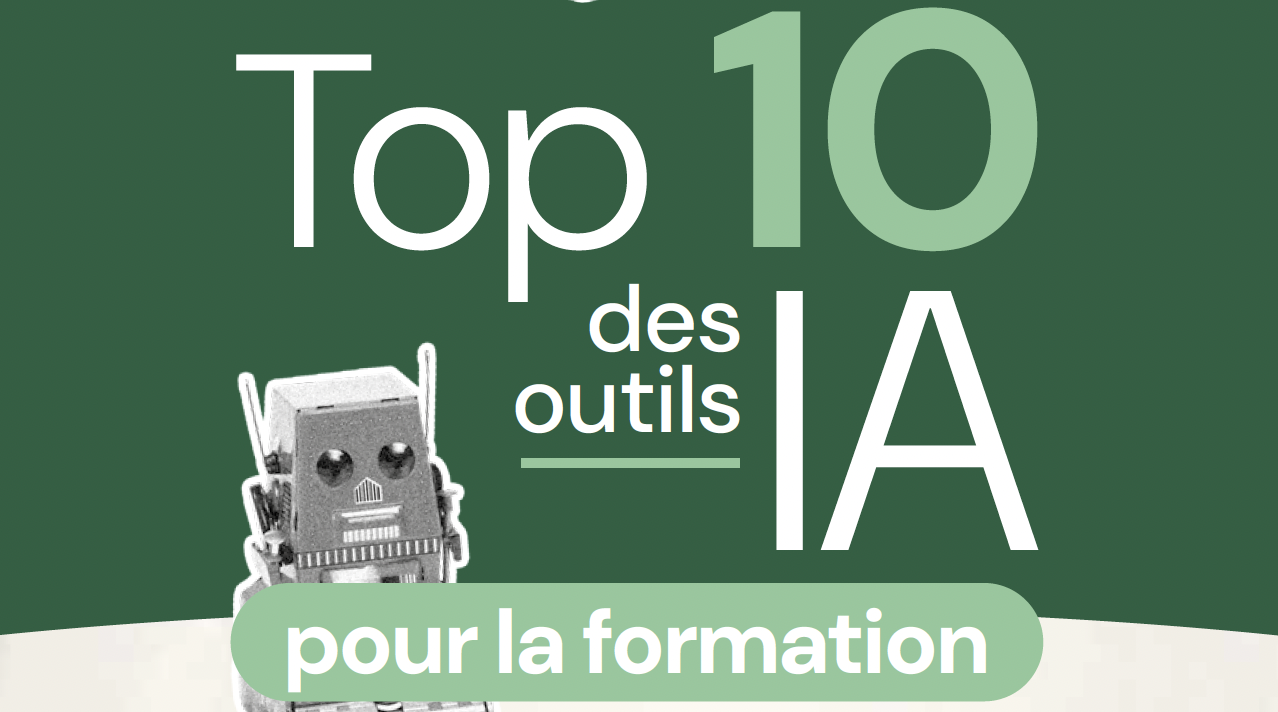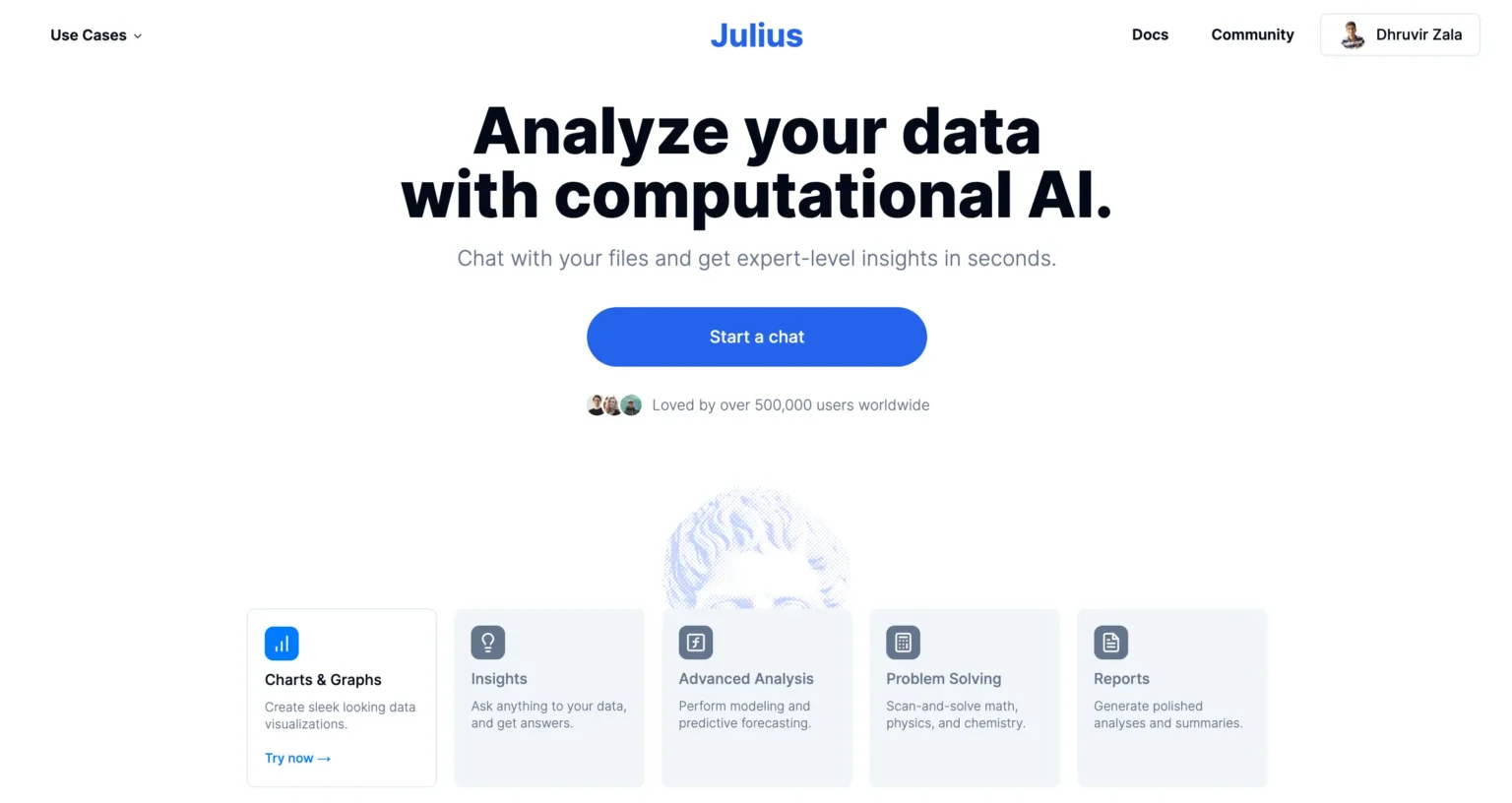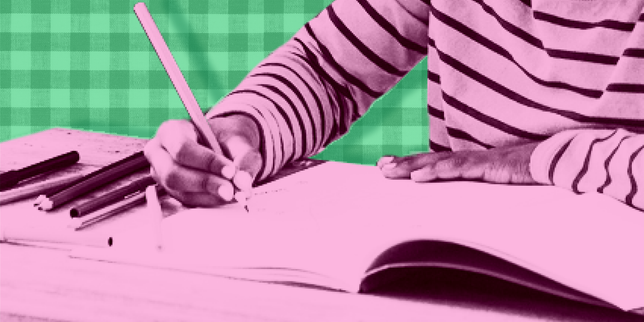Le prétendu échec de l’économie de l’offre
C’est une petite musique qui monte : la politique économique des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron est un échec (c’est vrai), car c’est une politique de l’offre (c’est faux). Il est vrai que la situation de l’économie française n’est pas bonne. Le diagnostic est connu : faible croissance, investissements en berne, défaillances d’entreprises, chômage en hause, pouvoir d’achat […]

C’est une petite musique qui monte : la politique économique des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron est un échec (c’est vrai), car c’est une politique de l’offre (c’est faux).
Il est vrai que la situation de l’économie française n’est pas bonne. Le diagnostic est connu : faible croissance, investissements en berne, défaillances d’entreprises, chômage en hause, pouvoir d’achat menacé… Une partie de la classe politique, surtout à gauche, mais pas seulement, a trouvé le coupable : la politique de l’offre que mèneraient les gouvernements successifs sous les deux mandats d’Emmanuel Macron, politique qualifiée en outre de libérale, voire d’ultra-libérale. Même une partie du centre et de la droite semble sensible à cet argument : il serait temps de mettre fin à ce libéralisme supposé et à cette économie de l’offre (les « cadeaux » aux entreprises), pour aller vers des mesures plus interventionnistes. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir que nous sommes déjà en plein étatisme et bien loin d’une véritable économie de l’offre.
En réalité, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont tous continué la tradition interventionniste et keynésienne française. Quoi qu’ils en disent, on est totalement dans les politiques de relance keynésienne, avec des dépenses et des déficits publics records : si la relance keynésienne marchait, nous serions champions du monde de la croissance. Ce que la gauche appelle « la politique de l’offre » d’E. Macron, ce sont les aides aux entreprises et la flat tax sur les revenus du capital. Les aides aux entreprises (les fameux « 200 milliards de cadeaux fiscaux ») n’ont rien à voir avec une politique de l’offre ; il s’agit simplement du fait que l’Etat, via les impôts et cotisations sociales, augmente fortement les relèvements sur les entreprises et, pour en limiter les dégâts, leur en reverse une partie sous forme de subventions ou d’exonérations. Comment peut-on parler de cadeau, quand on vous prend de force 100 et que l’on consent à vous en rendre 20 ? La réalité n’est pas qu’on vous a fait cadeau de 20, mais qu’on vous a pris 80. Quant à la flat tax de 30% sur les revenus du capital, cela aurait été une bonne mesure d’économie de l’offre si le taux n’était pas aussi élevé (30%) et si la flat tax s’appliquait à tous les revenus ; disons que c’est au plus une mesurette, dans un océan de prélèvements.
La réalité, c’est que l’essentiel de la politique Macron n’a rien à voir avec l’économie de l’offre, mais peut être illustrée par le « quoi qu’il en coûte » : des dépenses publiques en hausse permanante, un record mondial de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires, qui n’empêchent pas dette et déficits records. Les « économies » des projets successifs de budget (Barnier, Bayrou, …) ne consistent pas à diminuer les dépenses, mais à en réduire légèrement la hausse. La réforme des retraites, même si elle a fait grand bruit, n’en n’est pas une et ne change rien au système par répartition étatique et obligatoire, ruineux et déficitaire. Donc dire que les difficultés économiques réelles, avec le ralentissement de la croissance et la hausse du chômage, accompagnés d’un pouvoir d’achat en berne, viennent de la politique libérale de l’offre menée par les gouvernements successifs est une contre-vérité.
En quoi consistait alors une vraie politique de l’offre ? Ses origines sont lointaines et remontent au moins à Jean-Baptiste Say au début du XIXe siècle et à sa loi des débouchés (« l’offre créée sa propre demande »). Or l’offre est le fait des entreprises et des entrepreneurs, chers à Say. La politique de l’offre consiste donc avant tout à permettre aux entrepreneurs et aux entreprises de produite librement, avec le moins d’entraves fiscales ou réglementaires possibles. Si l’offre est vraiment libre, elle progresse, crée des richesses et des revenus, qui permettront d’acheter le production ainsi créée. Le moteur de la croissance, ce sont les entreprises et le moteur des entreprises, ce sont les entrepreneurs : les pénaliser, c’est détruire la croissance. La politique de l’offre, cela consiste avant tout à faire reculer l’Etat, les réglementations, la fiscalité, qui sont autant de freins à la croissance.
Le volet le plus connu concerne les impôts et plus généralement les prélèvements obligatoires. La fameuse courbe de Laffer montre que plus on augmente le taux de prélèvements, plus l’offre se réduit, faute d’incitation suffisante. . Tout le monde comprend qu’un impôt de 100% rapporte 0, car personne ne travaille pour rien. Mais un impôt de 90% (il a même existé en Angleterre, avant Madame Thatcher, un taux de 98% d’impôts sur les revenus de l’épargne) va détourner ceux qui pourraient entreprendre de produite, pour acheter, au lieu d’investir, des biens durables (voilà pourquoi les Anglais roulaient en Rolls, disait-on, au lieu d’investir dans les entreprises) ou de se lancer vers des spéculations improductives. Plus généralement, tout impôt réduit l’incitation à produire et donc la matière imposable elle-même. L’idée de Laffer est donc simple : il arrive un moment où, même du point de vue fiscal, l’impôt est tellement désincitatif, où que la matière imposable a tellement diminué qu’un impôt à taux élevé rapporte moins qu’un impôt à taux plus faible. Ici, l’économie de l’offre consiste donc à diminuer les taux d’imposition, afin d’encourager l’offre : c’est bon pour la croissance et c’est même bon pour le rendement fiscal : le taux est plus faible, mais la matière imposable plus large. Dans cette logique, tout impôt progressif est désincitatif et la flat tax (l’impôt proportionnel) est préférable.
A vrai dire, Laffer n’a rien inventé et dès le XIX° siècle les professeurs de finances publiques disaient à leurs étudiants « les hauts taux tuent les totaux » ! Aujourd’hui, ion dit « l’impôt tue l’impôt » ou « trop d’impôts, pas d’impôts », c’est la même chose. Mais Turgot le savait déjà eu XVIIIe siècle. Voltaire raconte en effet dans sa Diatribe à l’auteur des éphémérides, que quand Turgot avait en 1775 réduit de moitié l’impôt sur la marée fraiche, l’année suivante, il y eut 596 charriots de poissons, au lieu de 153 l’année précédente. Voltaire commente : « donc le roi, sur ce petit objet, a gagné plus du double ; donc le vrai moyen d’enrichir le roi et l’Etat est de diminuer tous les impôts sur la consommation ; et le vrai moyen de tout perdre est de les augmenter ».
Mais ‘économie de l’offre ne se réduit pas à la question fiscale, même si elle est essentielle. Il s’agit de réduire tous les obstacles qui freinent le développement de l’offre. Quelques exemples suffisent à le comprendre. Dans beaucoup de secteurs il existe des professions fermées, ce que le rapport Rueff-Armand avait déjà dénoncé en 1959 : ne pas pouvoir s’installer librement dans une profession réduit la concurrence et pénalise la croissance, tout en augmentant les prix. Il y a eu quelques évolutions, mais bien insuffisantes. De même, plus les entreprises grandissent, notamment en nombre de salariés, plus les réglementations et les charges sont contraignantes : ce sont les effets de seuil, qui souvent conduisent les entreprises à ne pas embaucher, pour ne pas franchir le seuil entrainant de nouvelles contraintes.
Tout ce qui limite la liberté des prix (contrôle ou blocage), créant de « faux prix », au sens de Rueff, freine l’offre. On connait les effets du blocage des prix créant la pénurie, comme on l’a vu pendant a Révolution avec la loi sur le Maximum : à ce prix-là, personne ne produit, ou alors au marché noir, dont le prix est libre. Mais ce qui est vrai pour les produits l’est aussi pour l’épargne (taux d’intérêt artificiels) et pour le marché du travail (‘SMIC et autres) : là aussi, libérer les prix, c’est libérer l’offre. Et comme la concurrence joue, on a vu dans l’après-guerre que les prix montaient moins en Allemagne, où ils étaient libres, qu’en France, où ils étaient contrôlés !
Plus généralement, l’économie de l’offre consiste donc à réduire les obstacles qui freinent le développement des entreprises et la liberté des entrepreneurs. Elle n’a rien d’idéologique, mais elle part d’une réalité simple : ce sont les entrepreneurs qui créent des richesses, en créant ce qui n’existait pas jusque-là, et ils le font dans les entreprises, grâce au travail et au capital, aux salariés et aux épargnants. Les entrepreneurs, comme tout le monde, suivent leurs propres intérêts et c’est ainsi qu’ils répondent aux besoins des clients : Adam Smith l’avait déjà bien expliqué. Dans ces conditions, les entrepreneurs agiront d’autant mieux que l’on ne les en aura pas empêchés par des obstacles mis en place par l’Etat. La politique de l’offre est donc le contraire de l’interventionnisme, puisqu’elle consiste à diminuer fiscalité et réglementations. Contrairement aux idées reçues, il n’y a donc pas de politique plus « sociale » que la politique libérale de l’offre, puisque chacun pourra en bénéficier, grâce à la croissance et à l’emploi, ainsi créés, et donc grâce au pouvoir d’achat distribué via les entreprises et aux prix maitrisés par la concurrence.

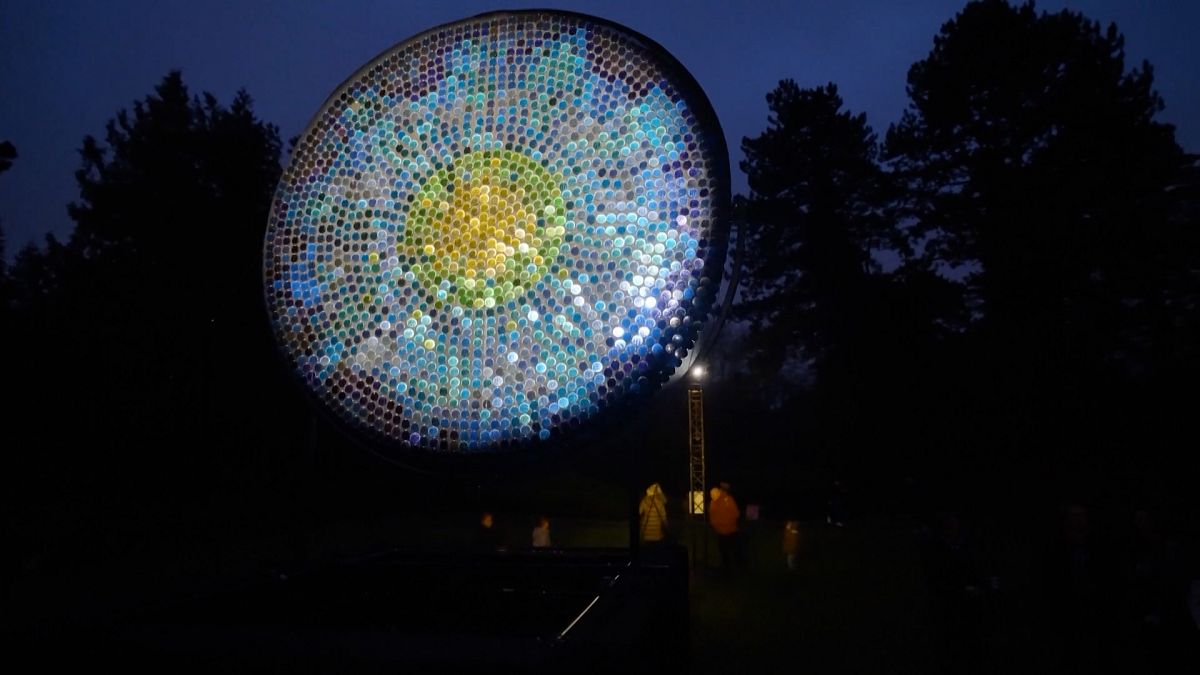
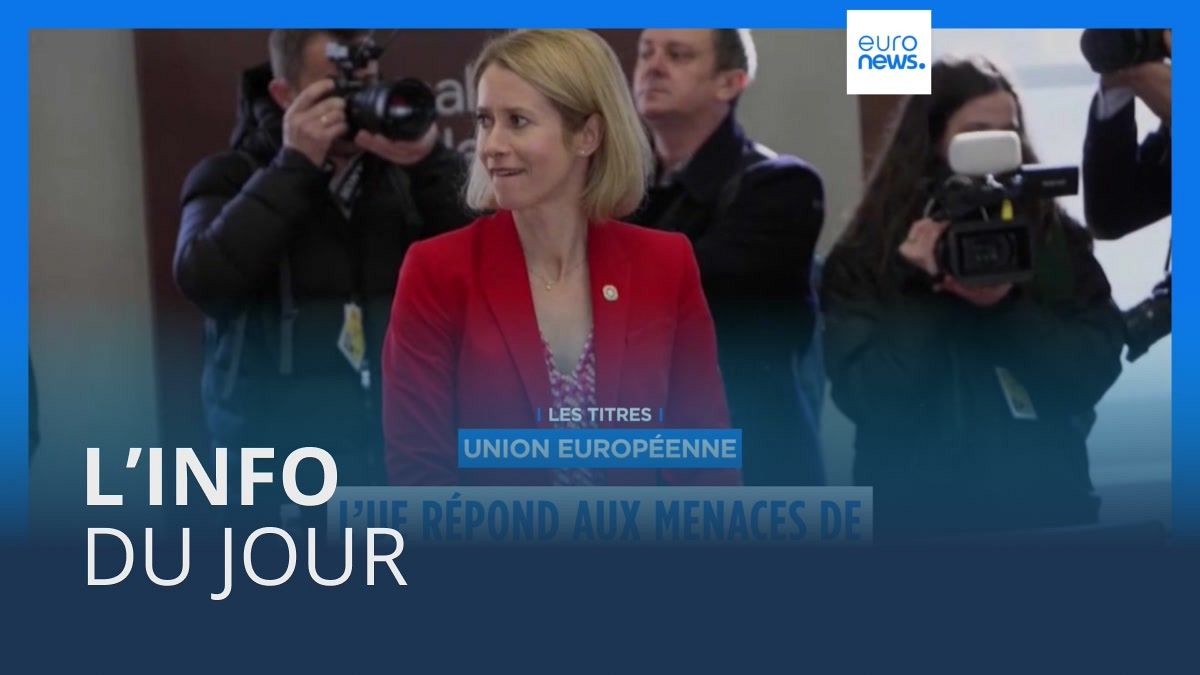
















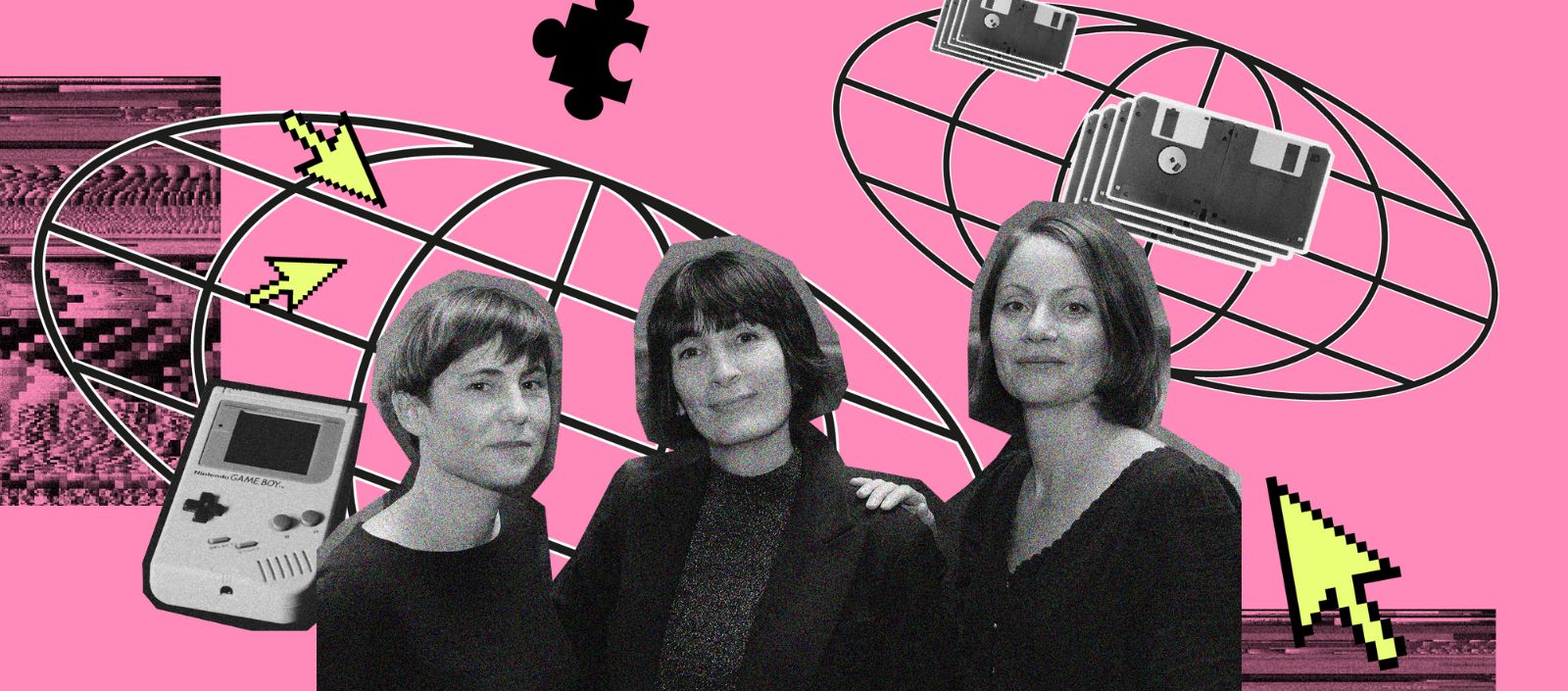
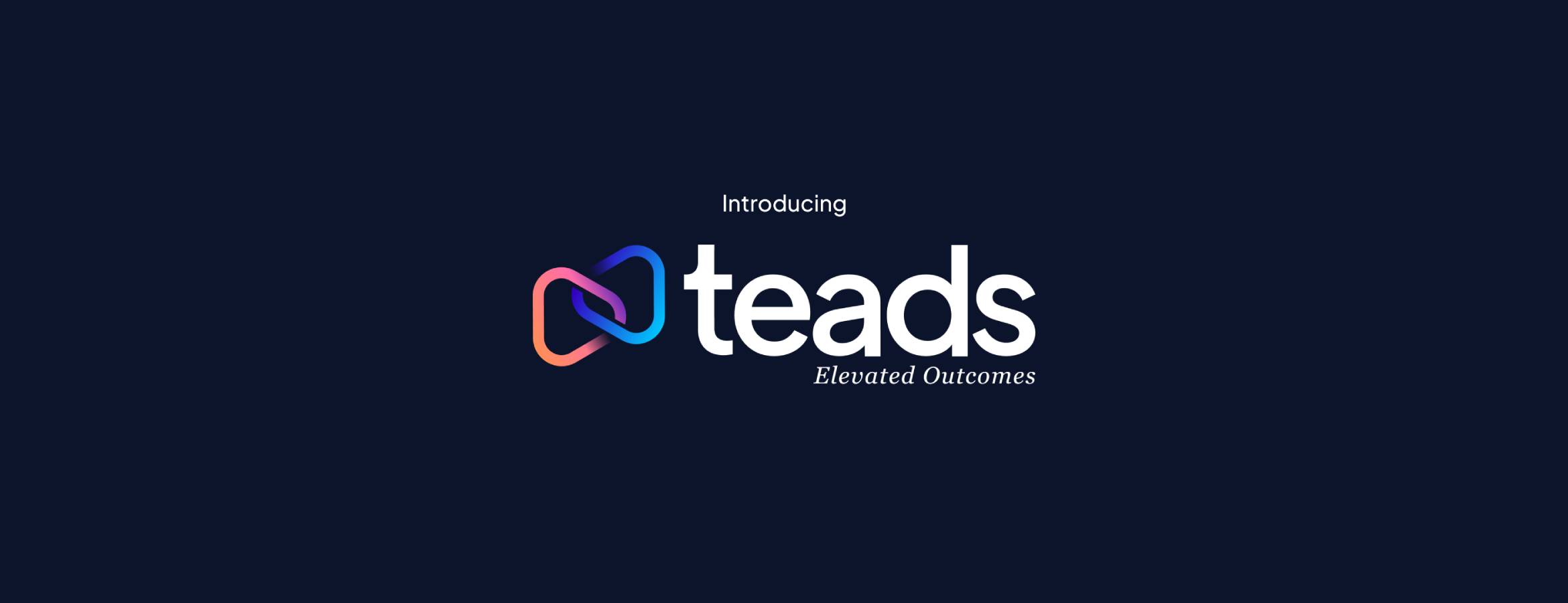
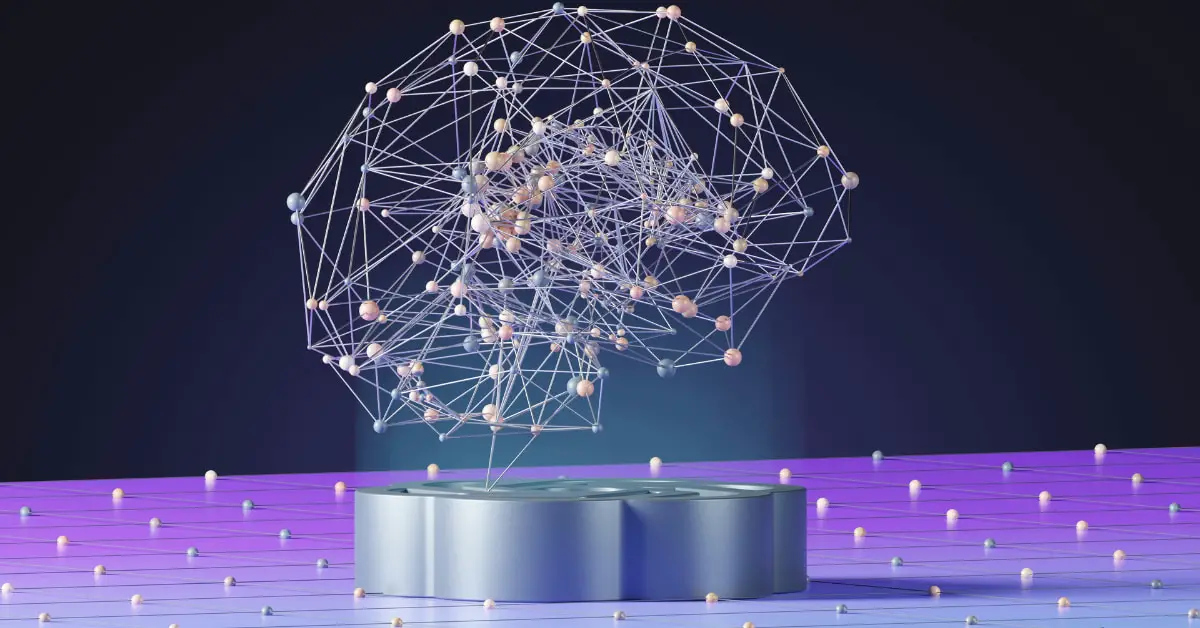



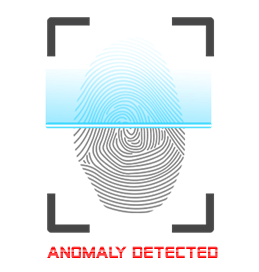



![[MàJ] Apple valide la première application porno sur iPhone](https://static.iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2025/02/Hot-Tub-Application-iPhone.jpg)