Notre démocratie est-elle minée par l’élection du président de la République au suffrage universel ?
L’élection du président de la République au suffrage universel direct serait-elle au fondement de la crise politique et institutionnelle que connaît la France depuis la dissolution de juin 2024 ?

L’élection du président de la République au suffrage universel direct serait-elle à l’origine des (nombreux) problèmes institutionnels rencontrés par le pays depuis la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024 ?
Il semble que la prochaine présidentielle soit attendue comme le remède à tous nos maux institutionnels – avec la perspective d’un retour à un fait majoritaire rassurant, où le nouvel élu bénéficierait d’une majorité suffisante à l’Assemblée nationale pour gouverner le pays sereinement durant cinq ans.
Or, l’élection du président ne constitue nullement la solution, mais la cause, profonde et ancienne, de ces difficultés institutionnelles. Ce mode de désignation du chef de l’État n’est certes pas une exception française, même en Europe : il existe en Autriche, en Irlande ou au Portugal, par exemple. Ce qui, en revanche, singularise nos institutions, c’est que le président de la République, fort de sa légitimité électorale, prétend gouverner en lieu et place du chef du gouvernement.
Une configuration institutionnelle absurde
Contrairement à une idée reçue, le pouvoir du chef de l’État sous la Ve République ne tient ni à son élection directe ni aux prérogatives que lui confère le texte constitutionnel, mais au fait que, depuis 1958, c’est lui qui bénéficie du soutien de la majorité parlementaire – et non le premier ministre, lequel lui est dès lors politiquement soumis. Les élections législatives sont même devenues, depuis la réforme instaurant le quinquennat (2000, effective en 2002), de simples élections « de confirmation », tout juste destinées à conférer au vainqueur de la présidentielle la majorité dont il a besoin pour gouverner.
Cette configuration, sur le plan institutionnel, est absurde : elle revient à faire élire séparément la majorité parlementaire et son chef – alors que partout ailleurs en Europe, le leader de la majorité émerge logiquement des suites (et en fonction) du résultat des élections législatives. Nous faisons en deux temps ce qui, partout ailleurs, est réalisé en un seul.
Ce système a profondément (quoique progressivement) transformé la culture politique dans notre pays. Il suffit pour le constater de songer aux transformations subies par les partis. Initialement, ils ont joué un rôle assez traditionnel de production de programmes et de présélection des élites gouvernantes – notamment des candidats à l’élection présidentielle : ces derniers, pour avoir une chance de l’emporter, devaient (dans une logique très parlementaire) d’abord « prendre le parti ».
On voit combien les choses ont évolué depuis lors, du fait du poids croissant de l’élection présidentielle : après avoir assisté au phénomène des primaires (lesquelles ont consisté à retirer aux partis le choix de leurs candidats), on a vu éclore le phénomène des partis « personnels », construits autour d’une personnalité, et formés seulement pour en soutenir sa candidature. Les partis se sont donc calqués sur la configuration institutionnelle que l’on connaît : d’abord l’élection d’un homme, ensuite la désignation de « troupes parlementaires » destinées à en suivre les orientations.
Une conception appauvrie de la démocratie
Loin de la figure d’arbitre au-dessus de la mêlée partisane défendue par de Gaulle en 1958, le président de la République est bien devenu, du fait de son élection au suffrage universel direct, le chef d’un camp (vainqueur d’un autre, au second tour) – un chef partisan, ayant remporté des élections compétitives, et qui prétend en conséquence gouverner. Cumulant le statut officiel de chef de l’État et celui, officieux, de chef du gouvernement (le premier ministre ne pouvant plus apparaître que comme un simple « collaborateur »), il veut bénéficier de la protection due au premier, tout en assumant les pouvoirs de gouvernement du second : or, la combinaison entre de larges pouvoirs et une totale irresponsabilité n’est ni très appropriée ni très saine.
Mais surtout, tout notre système politique étant organisé autour de l’élection d’un homme, il tend à installer dans la culture politique française une représentation très appauvrie de la démocratie, réduite à la simple capacité des citoyens à se choisir périodiquement un chef. Or, cette conception de la démocratie n’est pas seulement pauvre : elle est dangereuse. Elle sécrète fatalement une attente, celle de l’homme providentiel, capable de résoudre toutes les difficultés et investi par le peuple d’une mission quasi messianique.
Les candidats à la fonction que l’on dit (significativement) « suprême » sont encouragés à apparaître comme providentiels, et à multiplier les promesses excessives – lesquelles sont immanquablement déçues par la suite. Cette succession d’annonces d’un avenir radieux et de désillusions abyssales ne fait que ruiner la confiance des citoyens dans les institutions. Bref, l’élection du président au suffrage universel, loin de réaliser la démocratie, la mine de l’intérieur.
Les mandats d’Emmanuel Macron, un condensé des dérives institutionnelles de la Vᵉ République
Les deux mandats d’Emmanuel Macron illustrent parfaitement cette analyse. Après avoir incarné, en 2017, une promesse de renouvellement profond, à la fois, de la classe politique française et de ses usages, il a tôt fait de décevoir les espoirs placés en lui, et n’a remporté un second mandat, en 2022, qu’en raison de l’identité de son adversaire. Du reste, les élections législatives qui ont suivi n’ont pas donné, pour la première fois depuis l’instauration du quinquennat, de majorité absolue au vainqueur de la présidentielle.
Dans n’importe quelle autre démocratie parlementaire, le résultat de ces législatives de 2022 aurait forcé les partis arrivés en tête (ceux de l’ex-majorité présidentielle) à négocier avec des forces d’appoint (en l’occurrence, Les Républicains, LR) pour produire un accord de gouvernement leur permettant de conduire ensemble la politique de la nation. Il n’en a rien été. Le président a estimé pouvoir nommer un gouvernement constitué de ses seuls soutiens, et LR a préféré s’afficher comme un parti d’opposition.
Pourtant, d’un côté comme de l’autre, cela ne pouvait relever que de la posture : les gouvernements d’Élisabeth Borne ou de Gabriel Attal ne pouvaient avoir une chance de se maintenir qu’avec le soutien de LR. De fait, l’essentiel des projets de loi gouvernementaux, entre 2022 et 2024, ont été conçus avec l’appui inédit du Sénat (dans lequel la droite reste traditionnellement majoritaire) et avec le soutien non assumé quoique constant des députés LR, qui se sont toujours abstenus de voter les motions de censure déposées par l’opposition.
Il s’est donc agi d’une sorte de coalition implicite, qui est restée dans l’ombre simplement parce que notre régime « parlementaire » est perverti par cette élection du président au suffrage universel. C’est bien, en effet, parce qu’Emmanuel Macron avait remporté la présidentielle de 2022 qu’il a pu prétendre mettre en œuvre son programme sans compromis aucun, en dépit de résultats aux législatives qui n’auraient pas dû le lui permettre.
Cette coalition a fini par s’afficher comme telle seulement en 2024 et parce que cela lui était devenu nécessaire pour se maintenir au pouvoir. Ne bénéficiant plus de suffisamment de députés pour former à elles seules une majorité absolue à l’Assemblée nationale, ces forces politiques ont dû assumer leur alliance afin de justifier leur droit à composer le gouvernement (avec l’appui du président de la République). De fait, celui dirigé par Michel Barnier comme celui constitué par François Bayrou ont été essentiellement composés de ministres issus de cette coalition passée, par la force des choses, de l’ombre à la lumière.
On le voit, l’élection du président est problématique aussi bien lorsque le système fonctionne « normalement », que lorsque la machine s’enraye. Du reste, alors que ce mécanisme de désignation du chef de l’État avait eu ses défenseurs au moment de son instauration, il ne se trouve aujourd’hui personne, parmi les spécialistes des institutions, pour le défendre d’un point de vue théorique (c’est-à-dire en exposant les avantages qu’il pourrait procurer).
Le seul argument que l’on oppose à ceux qui, de plus en plus nombreux, en signalent les défauts, est purement pragmatique. Les Français, explique-t-on, sont attachés à l’élection présidentielle – et une suppression de celle-ci serait sans doute mal vécue : nul besoin donc de discuter d’une réforme qui n’aurait que peu de chances d’advenir. On admettra que cet argument a tout de la prophétie autoréalisatrice : si l’on n’en parle pas, il y a peu de chances de voir les critiques que mérite cette élection directe finir par convaincre qui que ce soit. Peut-être est-il temps, enfin, de mettre sérieusement cette élection en question.![]()
Arnaud Le Pillouer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.









![[ANIMAUX] Toto et Rillette sauvées de l’abattage : les leçons des deux affaires](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/sanglier-ia-616x347.jpg?#)

![[ÉDITO] TVA et auto-entrepreneurs : arrêtez d’enquiquiner les braves gens](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2023/04/Artisan-menuisier--616x411.jpg?#)




























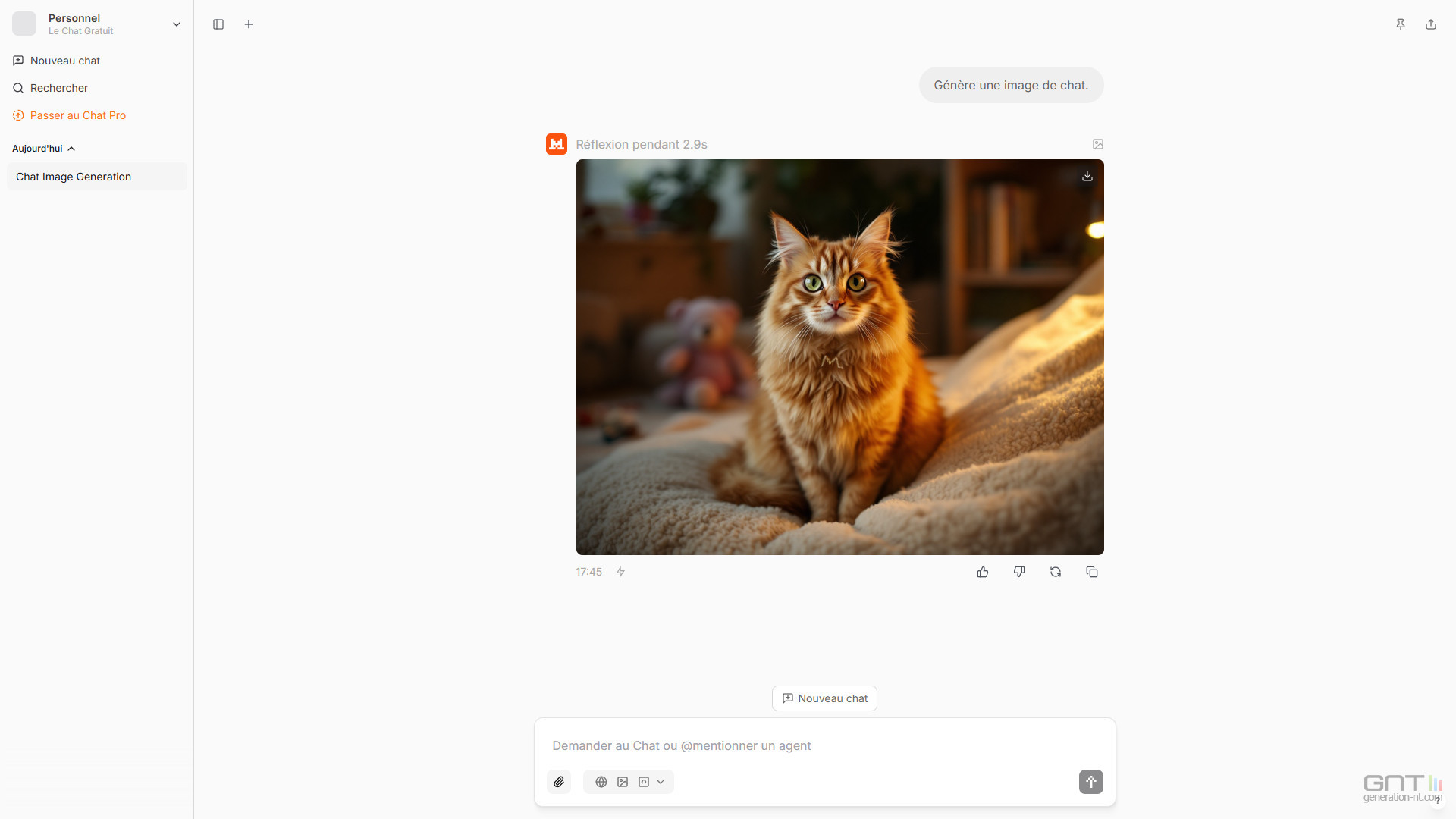



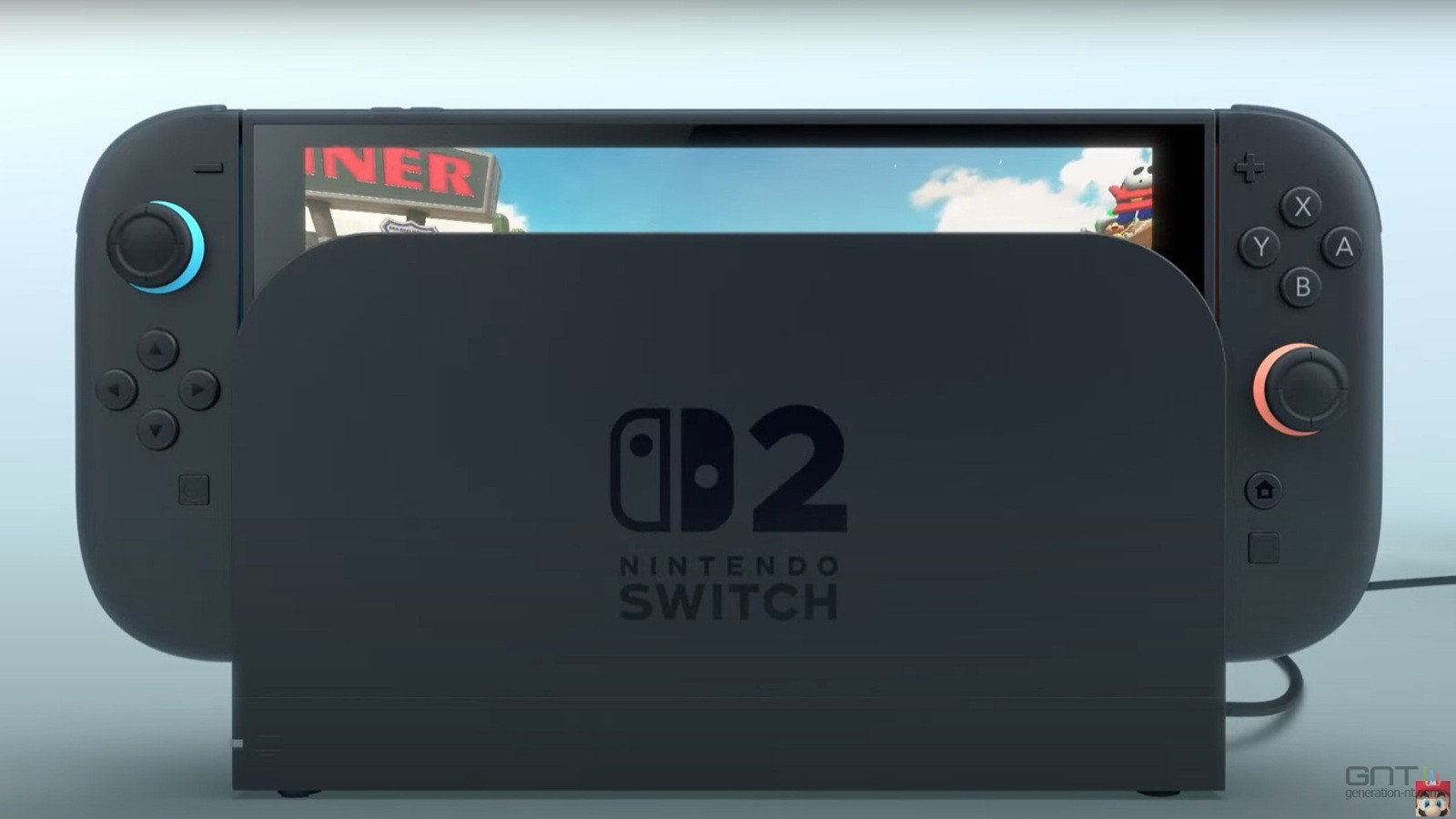







![Flexibilité : la CRE compte sur le marché [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6.png)


















