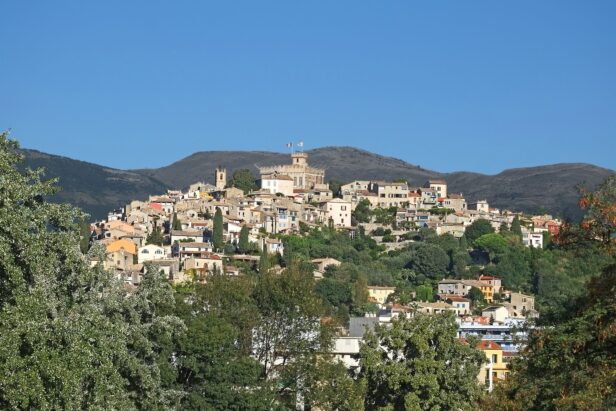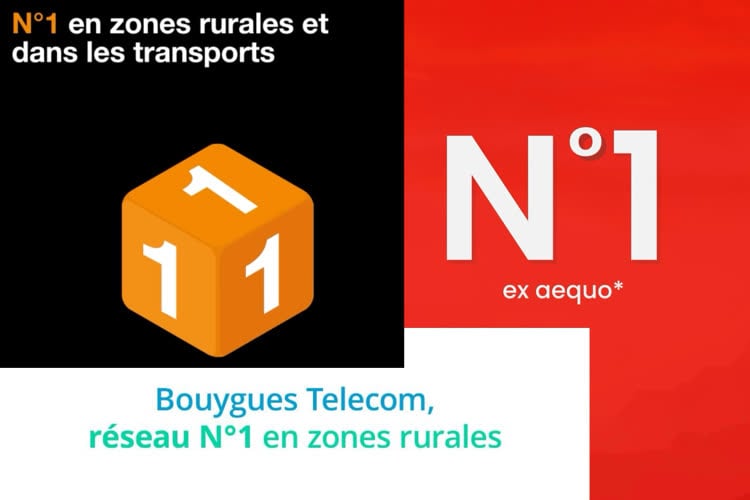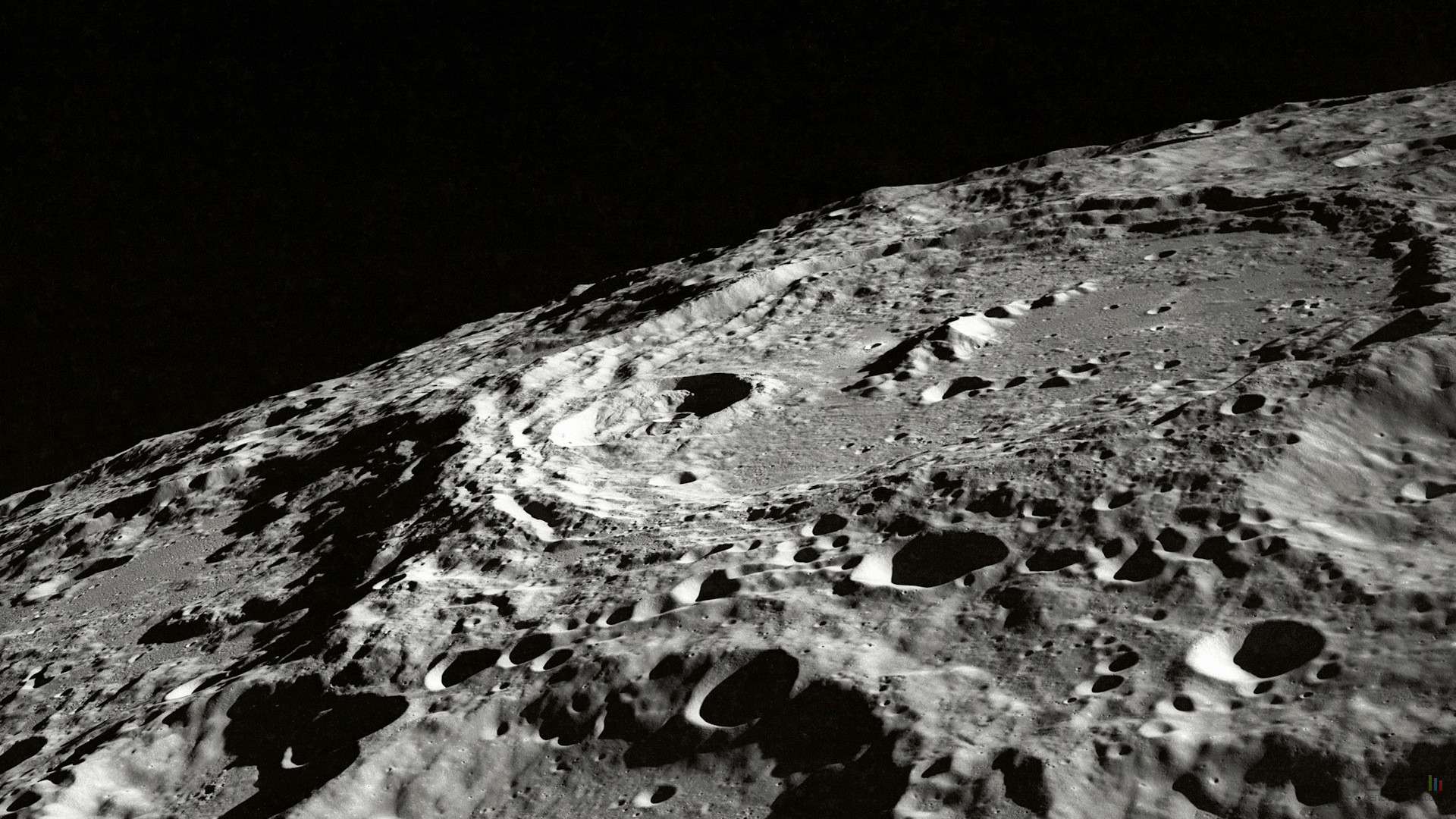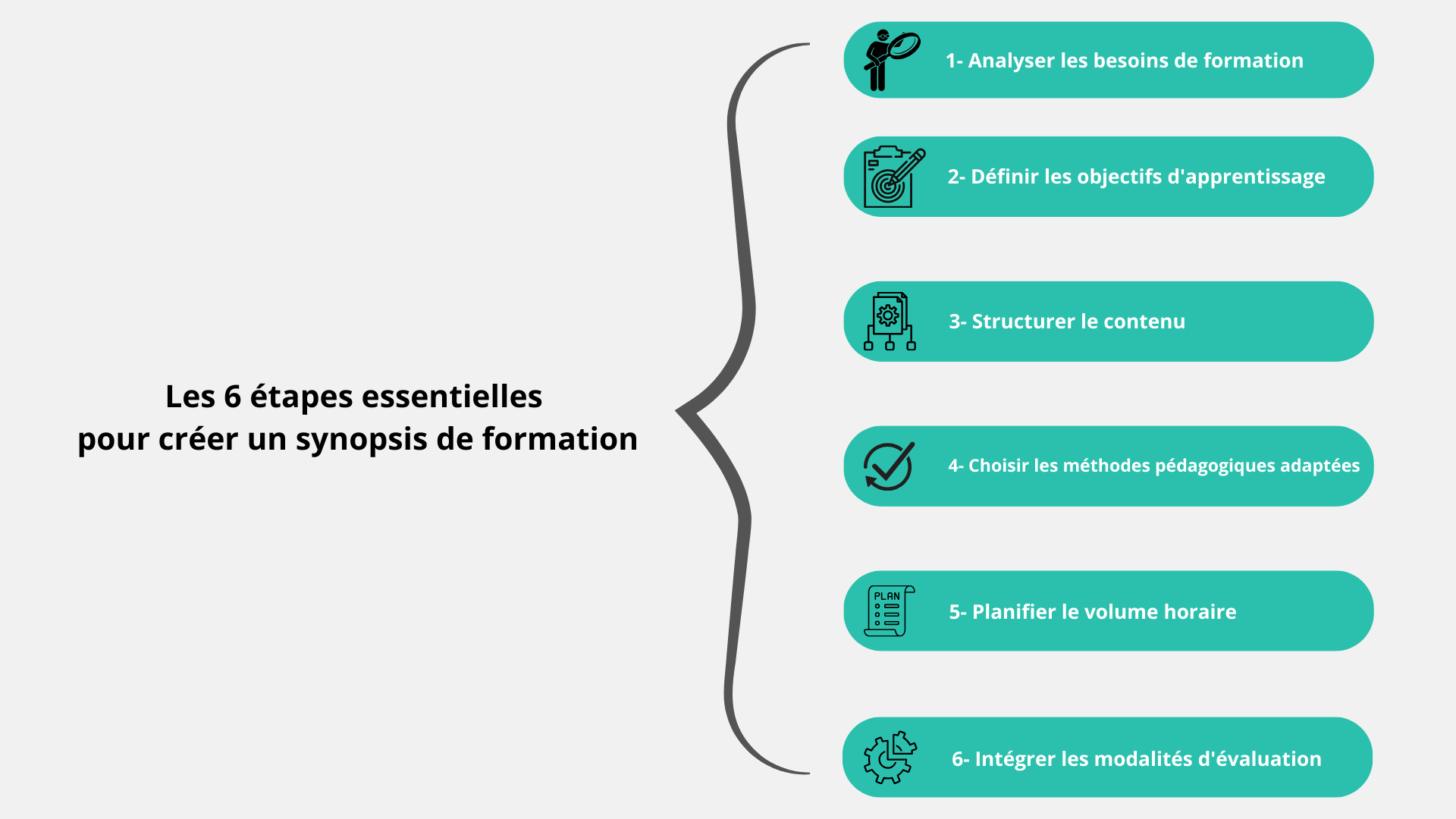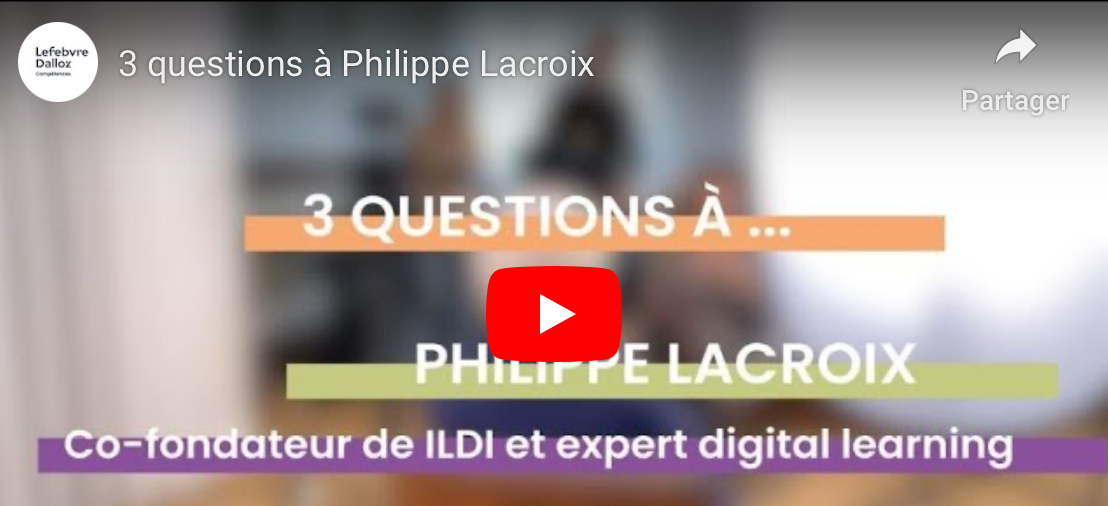Avec Bart De Wever, quel avenir pour la Belgique ?
Bart De Wever, le nouveau premier ministre belge, va gouverner le pays à la tête d’une coalition hétéroclite, mais formalisée par un contrat qui la contraint à appliquer un programme précis.

Il aura fallu huit mois de négociations pour que Bart De Wever, 54 ans, parvienne à créer une coalition et à obtenir sa nomination au poste de premier ministre de la Belgique. De Wever est le leader de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA), un parti qui se donne pour objectif ultime l’indépendance de la Flandre. Avec un tel homme à sa tête, la Belgique est-elle en danger d’éclatement ? Éclairage d’Audrey Vandeleene, chercheure postdoctorale au Centre d’Étude de la Vie Politique (Cevipol) de l’Université libre de Bruxelles, spécialiste de la vie politique belge.
Comment faut-il présenter le nouveau premier ministre de la Belgique ? Il est qualifié à tour de rôle de nationaliste, d’indépendantiste flamand, de conservateur, de confédéraliste, d’anti-monarchiste, voire de politicien d’extrême droite.. Qui est Bart De Wever ?
Tout d’abord, c’est aujourd’hui la personnalité politique la plus populaire de Belgique. Il a obtenu un succès indiscutable aux élections législatives du 9 juin 2024. Il dispose donc d’une vraie légitimité électorale. Les Belges le connaissent bien : il est présent au premier plan de la vie politique depuis maintenant une bonne vingtaine d’années puisqu’il est devenu le président du premier parti de Flandre, la Nouvelle Alliance flamande (N-VA) en 2004, donc il y a 21 ans. Et depuis 2013, il est le bourgmestre d’Anvers, l’une des plus grandes villes du pays.
Du point de vue des idées, c’est avant tout un nationaliste flamand. Il souhaite que la Flandre obtienne de plus en plus de compétences, voire qu’elle accède à l’indépendance. Mais il faut souligner que, avec les années, il est devenu de plus en plus pragmatique, du fait du succès grandissant de son parti. Si celui-ci a percé, au départ, grâce à sa posture nationaliste, il a aussi su progressivement séduire de plus en plus d’électeurs par son volet socio-économique. En Flandre, c’est cette dernière thématique qui constitue la première préoccupation de la population ; De Wever l’a compris, tout comme il a compris qu’il serait très compliqué de provoquer une scission de la Belgique et de parvenir à l’indépendance de la Flandre. D’où l’accent mis par son parti sur les questions socio-économiques au détriment du projet indépendantiste. Celui-ci reste présenté comme un objectif de long terme mais, désormais, la N-VA dit plutôt qu’elle veut défendre les Flamands au sein de la structure belge en donnant de plus en plus d’autonomie à la Flandre. D’où ce mot d’ordre de confédéralisme.
La Belgique est un État fédéral, ce qui signifie qu’un certain nombre de prérogatives relèvent non pas de l’État belge mais des Régions et des Communautés – je pense par exemple à l’enseignement, qui se fait dans des langues différentes et selon des programmes différents selon les Communautés (en français, en néerlandais et même en allemand). Le confédéralisme ne représenterait pas fondamentalement un changement de système mais de degré : dans un cadre confédéral, les Régions et Communautés, donc y compris la Flandre qui est en même temps une Région et une Communauté, disposeraient de prérogatives encore plus larges qu’aujourd’hui.
Pourquoi De Wever s’est-il allié à plusieurs partis souvent assez éloignés de son idéologie, mais pas avec le Vlaams Belang, parti indépendantiste flamand classé clairement à l’extrême droite, et qui est arrivé en tête aux élections européennes tenues le même jour que les dernières législatives ?
Parce que De Wever, s’il est certes de droite, est profondément hostile à l’extrême droite, tout simplement. S’il l’avait voulu, il aurait pu s’allier avec le VB après les élections régionales de 2019 ou après celles de 2024 : chaque fois, ces deux partis sont arrivés en tête en Flandre, et auraient donc pu gouverner la Flandre ensemble. Mais De Wever s’y est toujours refusé. Il applique ce qu’on appelle le cordon sanitaire : à ses yeux, hors de question de passer alliance avec l’extrême droite.
L’une des raisons pour lesquelles, en France notamment, on classe parfois la N-VA et De Wever lui-même à l’extrême droite, c’est que, au Parlement européen, ce parti siège au sein du groupe Conservateurs et réformistes européens, aux côtés par exemple du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia…
C’est vrai, mais cette formation européenne n’est pas la plus droitière au sein du Parlement européen. Le Vlaams Belang, lui, siège au sein du groupe « Patriotes pour l’Europe », avec notamment le RN français, les Espagnols de Vox, le FPÖ autrichien ou encore la Lega italienne, le parti de Matteo Salvini, qui est un groupe plus à droite que celui dans lequel siègent les euro-députés N-VA, et qui se distingue par son euro-scepticisme, ce que n’est pas la N-VA. Les positions de la N-VA sont aussi nettement plus modérées que celles du Vlaams Belang sur de nombreux points, par exemple sur l’immigration. La N-VA se voit comme une formation de droite conservatrice, et est souvent en Flandre présentée comme un parti de centre droit, pas comme un parti d’extrême droite. C’est un parti qui, toutes choses égales par ailleurs, est un peu comparable, en termes de positionnement, aux Républicains en France.
Mais au Parlement européen, la N-VA ne siège pas dans le même groupe que Les Républicains, qui sont au Parti populaire européen (PPE)…
Cela s’explique avant tout par le fait qu’il y a en Flandre deux grands partis de droite, qui sont concurrents : la N-VA et l’Open-VLD, le parti du prédécesseur de De Wever au poste de premier ministre, Alexander De Croo, qui était en poste depuis 2020. Et l’Open VLD appartient au PPE, d’où la volonté de la N-VA de choisir un autre camp au niveau du Parlement européen.
Ce qui surprend, vu de France, c’est que la N-VA, qu’on assimile donc à Fratelli d’Italia du fait de son positionnement au Parlement européen, s’apprête à gouverner la Belgique à la tête d’une coalition extrêmement disparate, où l’on retrouve notamment des socialistes…
Il est vrai que cette coalition, surnommée Arizona car les couleurs des partis qui la composent évoquent celles du drapeau de l’Arizona, est assez spéciale. On y retrouve, outre la N-VA, deux autres partis flamands – les chrétiens-démocrates (CD&V) et les socialistes (Vooruit) –, ainsi que deux partis francophones : le Mouvement réformateur (qui est un parti libéral) et les Engagés, classés au centre.
Comment expliquer la formation d’une coalition aussi hétéroclite ?
Elle s’est un peu formée par élimination. La N-VA, je l’ai dit, ne voulait pas du Vlaams Belang, et les autres grands partis, flamands comme francophones, en voulaient encore moins, car il y a un accord entre partis démocratiques sur le respect du cordon sanitaire. Ensuite, l’Open VLD, qui était au pouvoir avec Alexander De Croo, a subi une déroute dans les urnes aux législatives de 2024 (un peu plus de 5 % des suffrages) et il n’aurait donc pas été crédible qu’il fasse à nouveau partie du gouvernement. De la même manière, les socialistes francophones, qui s’appellent tout simplement Parti socialiste, ont eux aussi chuté à ces législatives (8 %) par rapport aux précédentes. De Wever a donc fini par trouver un terrain d’entente avec ces quatre autres formations : à eux cinq, les partis formant sa coalition pèsent 82 sièges sur les 150 que compte le Parlement belge.
Les négociations ont duré huit mois. Qu’est-ce qui en a émergé ? Un accord a minima, ou bien un programme commun détaillé, une feuille de route que des partis aussi différents pourront mettre en œuvre ensemble ?
C’est un accord de gouvernement qui est très précis, qui a d’ailleurs été en bonne partie déjà rendu public. Le niveau de détail de cet accord reflète d’ailleurs l’extrême prudence, voire le manque de confiance réciproque entre les partenaires. C’est une sorte de contrat de coalition, à l’allemande, auquel tous les partenaires devront se tenir.
Quelles sont les principales dispositions de cet accord ?
C’est un accord qui, sur le plan économique, est marqué par une vision libérale, de droite. Par exemple, il y aura des restrictions dans le temps des allocations de chômage, ainsi que des révisions des conditions d’octroi de certaines allocations sociales et des montants de certaines pensions. La plupart de ces mesures ne vont pas faire plaisir aux classes sociales les moins aisées.
Les socialistes flamands qui participent à la coalition ne sont-ils pas, dès lors, les dindons de la farce ? Une simple caution qui permet à une coalition de droite de tenir sur la durée ?
L’accord penche à tout le moins au centre-droit, mais contient quelques trophées décrochés par le seul partenaire de gauche, par exemple le départ à la retraite plus tôt si on a commencé à travailleur plus jeune ou encore un impôt sur les plus-values qui a été labellisé « contribution de solidarité ». Mais en tout état de cause, et même si l’avenir peut réserver des surprises, cette coalition devrait, a priori, tenir pendant plusieurs années. Ne serait-ce que parce qu’il fallu tellement de temps, huit mois, pour parvenir à un compromis. Les Belges n’ont pas envie de retourner aux urnes à court terme et les partis ne souhaitent pas à nouveau se lancer dans ce long processus de négociations, qui aurait peu de chances d’aboutir à une solution très différente de celle trouvée aujourd’hui.
Quelle est la place de la monarchie dans le système politique belge, et dans quelle mesure cette place est-elle menacée par l’arrivée au poste de premier ministre de Bart De Wever, un homme qui s’est dit à maintes reprises « républicain », donc désireux de mettre fin à la royauté ?
Le roi Philippe, qui a 64 ans et qui trône depuis 2013, peut, je pense, être tranquille, et sa fille Élisabeth, aujourd’hui âgée de 24 ans et qui lui succédera un jour, également. La remise en cause de la monarchie en tant que telle n’est pas à l’ordre du jour. En revanche, on observe depuis un certain temps, et cela va sans doute s’accentuer au cours des prochaines années, une diminution très nette du train de vie de la famille royale et, aussi, une réduction sensible du nombre de personnes dont on considère qu’elles représentent l’État en leur qualité de membres de la famille royale.
Dans la génération de la future reine, ses cousins et cousines, par exemple, ne peuvent plus compter sur la dotation, ce système qui leur assurait une vie très confortable auparavant sans exiger qu’ils exercent une activité professionnelle autre que la représentation de l’État. Ces jeunes nobles ont, pour la plupart, compris qu’ils devaient trouver un emploi et sont rentrés dans la vie active, car il n’y a plus de rôle officiel pour eux. Mais c’est désormais un sujet secondaire en Belgique. Le roi a un rôle symbolique, mais utile pour faciliter la formation du gouvernement ; d’ailleurs, De Wever l’a rencontré 17 fois entre les élections législatives et la rencontre lors de laquelle il a annoncé avoir trouvé un accord ! Le roi ne peut pas mettre son veto à la présence de tel ou tel parti ou personnalité au gouvernement, mais il peut donner un rythme, il peut donner des deadlines. Il joue un peu le rôle d’un chef d’orchestre, mais d’un chef d’orchestre auquel on imposerait la partition et les musiciens.![]()
Audrey Vandeleene ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)