Philippe Vilain est un « Mauvais élève » — et tant mieux pour nous
Il est bien dommage, affirme notre chroniqueur, que l’on n'ait glosé, en parlant du dernier opus de Philippe Vilain, que sur sa passion passée, dans les années 1990, pour Annie Ernaux, et sur son ébahissement devant ce qu’elle a fait de lui en 2022 dans Le Jeune homme, récit de leurs cinq ans de liaison. Mauvais élève est un très bon livre — et autrement meilleur que les autofictions répétitives du dernier Prix Nobel français de littérature... L’article Philippe Vilain est un « Mauvais élève » — et tant mieux pour nous est apparu en premier sur Causeur.

Il est bien dommage, affirme notre chroniqueur, que l’on n’ait glosé, en parlant du dernier opus de Philippe Vilain, que sur sa passion passée, dans les années 1990, pour Annie Ernaux, et sur son ébahissement devant ce qu’elle a fait de lui en 2022 dans Le Jeune homme, récit de leurs cinq ans de liaison. Mauvais élève est un très bon livre — et autrement meilleur que les autofictions répétitives du dernier Prix Nobel français de littérature.
Je n’ai jamais aimé Annie Ernaux, ni sa littérature. Je n’aime pas ce personnage éminemment construit, revendiquant des racines prolétaires qui n’ont jamais été les siennes. Elle appartient à cette petite-bourgeoisie plus conformiste, au fond, que la grande bourgeoisie, qui sait s’encanailler sans en faire des romans et améliore son pedigree avec un peu de sperme ouvrier, çà et là. Féministe par principe, elle a défendu Houria Bouteldja, épigone raciste, judéophobe et pro-islamiste du Parti des Indigènes de la République (la république algérienne, probablement) : en 2017 Ernaux cosigne une tribune de soutien à la rédactrice de Les Blancs, les Juifs et nous, brûlot raciste s’il en fut jamais. Une pétition dont Jack Dion, à l’aile gauche de Marianne (qui vient de le remercier) disait qu’il était « ahurissant d’allégeance à une dame qui a exposé son racisme au vu et au su de tous ».
Je sais toutefois un gré infini à Ernaux d’avoir illustré ce fameux « degré zéro de l’écriture » jadis théorisé par Roland Barthes, qui pensait que la vacuité absolue de l’expression était inatteignable — la preuve que non : il suffit de lire Le Jeune homme, l’un de ses derniers textes autobiographiques, paru la même année que son Nobel. J’ai dit à l’époque ce que j’en pensais — et il est diablement difficile de penser un tel objet littéraire. Il a fallu que je sorte mes balances en toile d’araignée pour peser cet œuf de mouche.
Comme quoi le néant même a un poids.
Je ne m’étais guère intéressé à l’anecdote biographique: une femme en pré-ménopause s’offre un amant de trente ans plus jeune qu’elle, joue avec lui à Pygmalion, le trimballe dans ses voyages comme un vanity case, en fait sa chose, son olisbos vivant — et s’en sépare lorsqu’elle constate qu’il a finalement plus de ressources qu’elle ne lui en supposait : ce fils de prolo — ce qu’elle n’a jamais été — a plus de volonté et de talent dans son petit doigt que notre romancière de gauche dans toute son illustre personne fanée. J’ai expliqué il y a peu, à propos de Babygirl, qu’un regain érotique anime parfois les femmes à l’aube de la sénescence. Oui, mais ceci compense-t-il cela ?
Mauvais élève est, bien plus qu’un règlement de comptes, un objet littéraire en soi, le récit (autobiographique) d’un garçon pré-condamné par son milieu et son inaptitude aux études à être OS ou manutentionnaire, et qui à force de travail, de foi en lui-même, malgré les épreuves, réussit à passer le Bac, à faire des études de Lettres et enseigne aujourd’hui la littérature française à Naples. C’est un texte magnifiquement écrit (heureusement pour nous, il a plus retenu Balzac ou Proust — qui « me terrifiait parce que je trouvais en le lisant tout ce que j’avais ressenti » — qu’Ernaux) ; un texte qui pourrait appartenir à cette « littérature prolétarienne » jadis instituée par Henry Poulaille et illustrée, entre autres, par Eugène Dabit — d’authentiques enfants d’ouvriers, l’un et l’autre.
La misère familiale et intellectuelle a façonné Vilain (il joue avec son patronyme avec un grand humour : « Ce nom, dit-il, il me fallait l’assumer », même s’il évoque « les servitudes féodales, les vies soumises, les méchants et la paysannerie dans ce qu’elle a de plus terrien »), et les livres l’ont sauvé : « Il n’existe sans doute pas d’asservissement plus grand que celui d’une vie sans livres » qui « en nous rendant incapables de décrypter le monde et de nommer précisément les choses, nous condamne à errer dans un monde absurde. »
Lire — et écrire : il se sent « appelé par les mots » — et il a bien fait de répondre à cet appel.
On mesure sa déception lorsqu’après son premier passage à Bouillon de culture (pour La Dernière année, paru en 1999, il entendit Ernaux, au téléphone, le crucifier d’un « j’ai eu l’impression de voir un fils d’alcoolique parler » — façon de le renvoyer à son passé, et de se démarquer à jamais, toute « de gauche » qu’elle se prétende, d’un « vilain » normand, la glaise d’Evreux ou de Vernon collée à ses chaussures de plouc perpétuel. Le mépris de classe est toujours plus fort dans les catégories intellectuellement proches de ce qui leur répugne.
Pour avoir enseigné au Neubourg, près d’Evreux, et avoir eu là des enfants d’ouvriers agricoles, pendant que les fils de bourgeois partaient chaque matin à Saint-Pierre Marie-Cécile à Evreux ; pour avoir été le premier dans ma famille à avoir le Bac, avec des parents qui à l’origine étaient sténodactylo (ma mère) ou flic de bureau (mon père) ; pour avoir détonné des années durant à l’ENS-Saint-Cloud, qui comptait peu de pauvres, je me suis senti en plein concernement en lisant ce très beau texte, où Vilain ne cherche pas à « venger sa race », comme dit l’autre, mais à nous expliquer comment on devient écrivain, et comment on s’extirpe des bras d’une mante religieuse qui se prend pour Pygmalion. Deux exploits, quand on y pense.
Bien sûr vous pourrez y chercher le détail de cette liaison déséquilibrée. Mais croyez-moi, c’est surtout la leçon d’écriture qu’il faut y lire — et la leçon de vie, lorsqu’on est parti d’en bas et que vous ne devez qu’à votre travail, à votre talent, et à votre sens du kairos de vous être imposé sur la scène littéraire. Si Ernaux préférait Venise, Vilain se sentit tout de suite chez lui à Naples — tout comme j’y ai moi-même respiré les effluves de mon enfance marseillaise : ses étudiants, là-bas, à l’Université Federico II, ont une vraie chance.
Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Laffont, janvier 2025, 236 p.
L’article Philippe Vilain est un « Mauvais élève » — et tant mieux pour nous est apparu en premier sur Causeur.
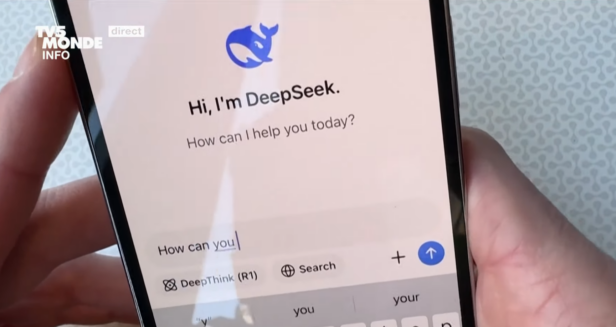


![[EXPO] Le musée Rodin tendance woke : sus à la grossophobie et au mâle blanc !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/vignette-rodin-balzac-616x347.jpeg?#)













































































