Les tentations droitières des patrons français ?
Bernard Arnault, PDG de LVMH, dénonce une France qui pousserait les entreprises à délocaliser et célèbre l’Amérique de Trump. D’autres patrons encensent l’Argentin Milei. Est-ce un tournant idéologique du patronat français ?

Bernard Arnault, PDG de LVMH, a dénoncé l’augmentation possible des impôts sur les entreprises françaises, évoquant un risque de délocalisation. Il a vanté le « vent d’optimisme » américain après avoir assisté à la cérémonie d’investiture du président Trump. D’autres patrons ou représentants du patronat espèrent l’arrivée d’un Milei français, faisant référence au président argentin ultralibéral. Le patronat français serait-il en pleine mutation idéologique et politique ?
Les patrons français seraient-ils séduits par la voie tracée par Javier Milei ou par celle de Donald Trump ? Mettre en parallèle le débat argentin et le débat états-unien avec la situation française n’a rien d’évident. En effet, les fondements idéologiques de certaines approches – telles que l’anarcho-capitalisme, le libertarianisme, ultra-libéralisme – restent très éloignés des débats français, tout comme l’idée de gouverner l’État comme une entreprise, souvent invoquée aux États-Unis. Les choses ont-elles changé avec les années Macron et sa « start-up nation » ?
« L’entreprise est la solution, l’État est le problème »
En France, les patrons votent majoritairement à droite depuis longtemps, mais leurs prises de position publique sont rares, sauf pour ceux qui entendent intervenir « dans le sens noble du terme » dans « la vie de la cité ». Leur parole est le plus souvent portée par des journalistes économiques qui relatent ce que les « milieux patronaux », souvent anonymes, leur disent ressentir.
Il y a toujours eu en France, depuis plusieurs décennies, le Medef ou certains grands patrons, et des éditorialistes libéraux notamment Nicolas Baverez, Olivier Babeau ou Nicolas Bouzou qui pensaient, voire disaient, que l’entreprise était la solution, et l’État le problème, qu’il fallait laisser faire les capitaines d’industrie et tous les entrepreneurs, seuls créateurs de richesse qui savaient mieux que les bureaucrates de Bercy ce qui était bon pour la France et pour les Français.
Ces revendications rampantes prenaient parfois la forme de campagnes, de rappels à l’ordre notamment, et de « benchmarking » (comparaisons) autour de la question des prélèvements obligatoires (par rapport aux démocraties similaires), de la simplification jugée indispensable des paperasses et des contraintes administratives pesant plus particulièrement sur les entreprises (même si nombre de professions et d’administrés peuvent aussi espérer un allégement et une clarification des formulaires de toutes natures). Le « choc de simplification » annoncé périodiquement et les multiples commissions et rapports sur la simplification, voire la loi d’Accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) de 2020, n’ont jamais comblé les attentes ou les espoirs de leurs assujettis.
Pourtant, « l’État-repoussoir » des différentes formes d’anti-étatisme s’est toujours accompagné d’une appétence étatique car les grandes entreprises sont aussi consommatrices d’État brancardier, d’État fournisseur d’aides et d’exemptions (les entreprises tendant la sébile comme l’on disait autrefois), ou d’État décorateur, dispensateur de médailles et d’honneurs. Il est vrai que nombre de grands patrons avaient commencé leurs carrières dans le giron étatique et avaient, avant de pantoufler, intégré l’ENA (certes réformée plusieurs fois) puis des administrations d’État et des cabinets ministériels, ce qui en faisait des patrons, mais des patrons d’État.
Emmanuel Macron, début 2017 était encore un deuxième choix face à François Fillon pour les milieux économiques et financiers, avant de devenir le champion du « pro-business » (mais sans « co-gestion » avec les grands patrons), pour terminer vilipendé, car considéré comme ayant été incapable de se défaire de ses oripeaux d’étatiste invétéré, et de dépensier compulsif (même si les mesures du « quoi qu’il en coûte » ont aidé de nombreuses entreprises).
Une petite musique libertarienne feutrée
L’actuelle petite musique « libertarienne » entendue chez certains patrons français existe, mais elle reste très feutrée. D’une part, ces appels au parricide de l’État sont minoritaires, souvent limité à des imprécateurs récidivistes qui ont un poids assez marginal dans le débat public comme Pierre Gattaz ou Sophie de Menthon. Malgré la sortie récente de Bernard Arnault revenant des États-Unis, les propos de plus grands patrons sont généralement des propos d’humeur ; même chez les déçus du macronisme de la start-up nation, il est peu vraisemblable qu’une gestion à la Musk ou à la Milei puisse faire référence.
De plus, les grands patrons français, Bolloré ou Stérin faisant grande exception, ont jusqu’à présent peu d’appétence pour la lutte politique ouverte. Ils ont toujours préféré la « quiet politics » et les divers raffinements du lobbying pour faire valoir leurs propres intérêts et pour initier ou propager une ligne doctrinale précise.
On voit mal Xavier Niel ou, dans un tout autre registre, Vincent Bolloré, faire un show électoral avec un tee-shirt RN aux côtés de Jordan Bardella, si tant est que ce dernier puisse être une option pour des grands patrons.
Mais le frisson politique qui a suivi la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 a fait dire ou penser, chez les grands patrons, « mieux vaut la RN que le NPF » – une partie des « petits » ayant déjà été conquise.
Sur le long terme, les grands (mais aussi les petits) patrons font profil bas politiquement : peu d’appels explicites à voter pour un candidat au premier tour, peu de présence physique aux meetings électoraux, dons discrets aux candidats de droite. D’ailleurs les différents garde-fous législatifs les protègent de cette tentation en matière de financement massif de causes et d’hommes politiques.
Financer la politique
La porosité formidable existant entre le champ politique et le champ économique aux États-Unis (comme le montre la composition du personnel politique états-unien et les nominations aux postes de ministres et de conseillers, particulièrement pour la future administration Trump), n’est pas transposable en France. Pourtant la frontière privé/public forcément poreuse est défendue par des casemates juridiques et politiques qui interdisent aux plus puissants d’intervenir aussi brutalement, par leur personne et leurs capitaux, dans la compétition politique.
Les patrons français peuvent donner ou prêter des fonds pour amorcer une campagne électorale, ils peuvent sans doute contourner certaines règles par de l’argent caché, mais ils sont bloqués par la limitation des dépenses électorales l’interdiction de la publicité politique la limitation des dons aux partis et aux candidats et le faible financement des think tanks, et aussi par des formes de fortes réprobations sociales. Ce sont des dizaines de milliers d’euros et non des milliards de dollars qui circulent. De ce fait, leur pouvoir de prescription et d’injonction public et privé s’en trouve amoindri.
Derrière les humeurs répétées anti-bureaucratiques voire anti-étatistes de grands patrons, se cache une claire volonté de déréglementation, soutenue par certains politiques français qui en appellent au « comité de la hâche ».
Le volontarisme qui a présidé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, est devenu une référence en matière d’accélération voire de contournement des contraintes et réglementations.
Notre-Dame oui, mais pas « Notre-Dame de Milei », pas avec la « tronçonneuse mileinariste » qui fait désormais figure de modèle pour Éric Ciotti.
Bernard Arnault peut dire être tenté de délocaliser aux États-Unis. En France, si « débureaucratisation » il y a, elle se fera « à la française ». Comme le dit David Lisnard, président de l’Association des maires de France « il faut cheffer l’État », pour « libérer la société », en supprimant d’abord la pléthore, selon lui, d’instances de contrôle et les postes strictement administratifs.
Michel Offerlé est l’auteur de Patron (éditions Anamosa, 2024).
Michel Offerlé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)





























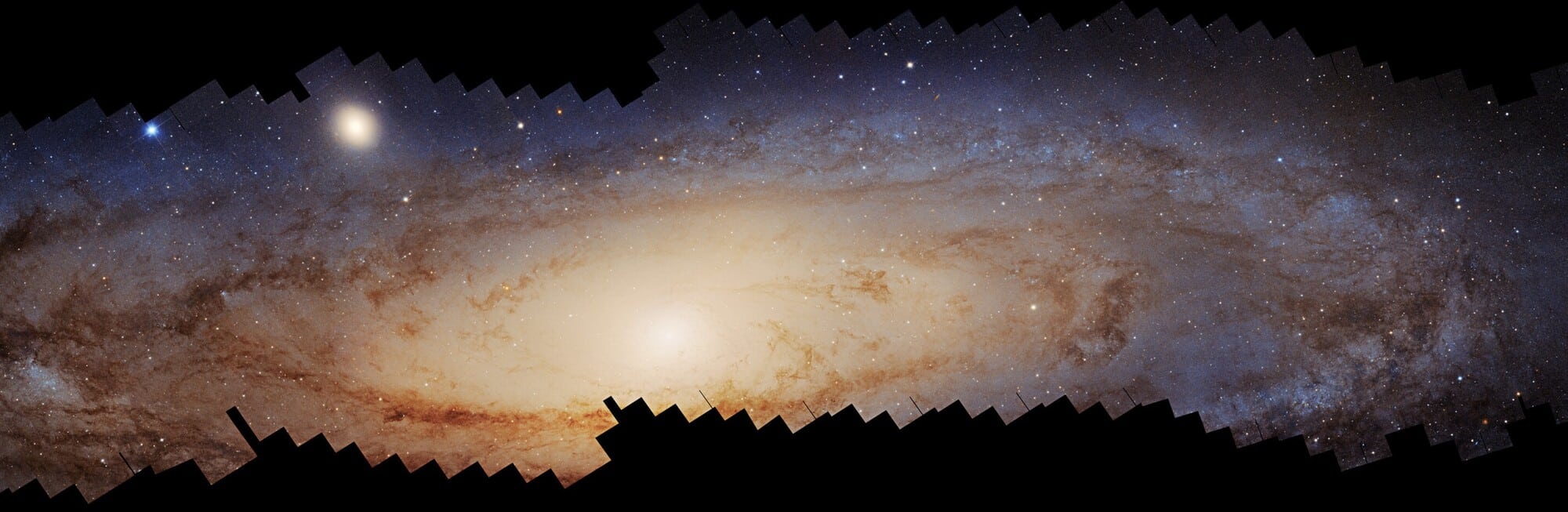
![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)