Les algues marines : une piste pour de nouveaux aliments riches en protéines
Laitue de mer, nori, dulse et autres algues marines sont des sources de protéines végétales alternatives à la viande, avec de réels atouts face aux enjeux planétaires et d’alimentation au quotidien.

Laitue de mer, nori, dulse… par leur composition nutritionnelle, les algues marines présentent des atouts pour répondre aux enjeux planétaires mais aussi d’alimentation au quotidien. Un programme est lancé en Bretagne pour pallier le manque de recherches autour de ces sources de protéines végétales alternatives à la viande.
Comment proposer de nouveaux aliments et ingrédients enrichis en protéines à partir de macroalgues cultivées pour le secteur de la santé ? C’est l’ambition du programme de recherche innovant PROMALG-Health ANR-23-DIVP-0005 qui vient d’être lancé en 2024.
Il est en effet essentiel de rechercher des sources de protéines alternatives à la viande, comme les algues, pour répondre aux enjeux majeurs à l’échelle mondiale, mais aussi à des problématiques d’alimentation au quotidien.

Chaque mardi, notre newsletter « Et surtout la santé ! » vous donne les clés afin de prendre les meilleures décisions pour votre santé (sommeil, alimentation, psychologie, activité physique, nouveaux traitements…) !
À l’échelle planétaire : insécurité alimentaire, obésité, environnement…
D’après les données récentes de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la faim dans le monde tend à augmenter en 2024, malgré des efforts importants pour garantir l’accès à des ressources alimentaires. En 2023, près de 2,4 milliards de personnes, soit plus de 30 % de la population mondiale, souffrent d’insécurité alimentaire modérée ou sévère. Ces chiffres témoignent de l’écart grandissant par rapport aux Objectifs de développement durables (ODD), en particulier l’objectif 2 qui vise à éliminer la faim dans le monde d’ici 2030.
Parallèlement, le régime alimentaire des pays en développement, notamment en Asie, tend à s’aligner sur les modèles occidentaux avec une consommation accrue de lipides et de protéines animales. Ce déséquilibre est connu pour entraîner surpoids et obésité, associés à une augmentation des risques de maladies chroniques tels que les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2.
La généralisation progressive de la tendance à consommer des protéines animales à l’échelle mondiale soulève également des problématiques environnementales liées à la durabilité des systèmes alimentaires, qu’il s’agisse des systèmes de production ou des industries de transformation. Ainsi, le véritable défi n’est pas seulement de limiter la consommation de protéines animales, mais aussi de proposer de nouvelles protéines alternatives, saines, permettant des régimes alimentaires nutritifs et mieux équilibrés, tout en étant plus durables d’un point de vue économique, social et environnemental.
Répondre à la dénutrition des personnes âgées au quotidien
Dans le cadre de la santé au quotidien, des enjeux en matière d’alimentation doivent également être pris en compte. C’est le cas en particulier, les phénomènes de dénutrition chez les personnes âgées qui restent d’actualité. Cette question a gagné en visibilité au cours des dernières décennies grâce à des études médicales et une meilleure compréhension des besoins nutritionnels liés à l’âge.
En effet, alors qu’elles nécessitent un apport en protéines plus élevé que les jeunes, une carence en protéines a été largement constatée chez les personnes âgées en raison d’une consommation calorique et protéique insuffisante. La prévalence de la dénutrition est alarmante parmi les personnes âgées de 70 ans et plus vivant en institution (15-38 %) ou à l’hôpital (30-70 %), comparativement aux personnes âgées vivant à domicile (4 à 10 %).
Dans les hôpitaux, pour les seniors mais aussi pour l’ensemble de patients, l’alimentation fait partie intégrante du traitement dès lors que les personnes hospitalisées dépendent du service de restauration collective hospitalière pour leurs besoins nutritionnels. Avec la loi EGAlim, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent offrir un accès à une alimentation saine, sûre et durable.
Depuis 2018, les restaurateurs servant plus de 200 repas par jour doivent ainsi se diriger vers une diversification des protéines, et donc vers des alternatives végétales. Augmenter l’apport en protéines en proposant de nouvelles recettes acceptables pour les seniors, sans les contraintes liées à la préparation des protéines animales et répondant aux attentes culinaires ainsi qu’aux conditions de restauration collective, constitue un défi de santé publique.
Cependant, maintenir un apport en protéines et une consommation de viande en institution se heurte aux croyances des seniors, mais aussi au défi de fournir des plats protéinés de qualité en restauration collective. La consommation de plats protéinés est également confrontée aux fortes attentes sensorielles et culinaires des résidents, qui ne sont pas toujours compatibles avec les contraintes de la restauration institutionnelle.
Les algues marines, sources d’acides aminés essentiels
En France, sur près de 75 000 tonnes d’algues produites chaque année en Bretagne, moins de 200 tonnes sont issues de l’aquaculture. Le reste, majoritairement des algues brunes, étant récolté dans les milieux naturels. Bien que les algues représentent un potentiel intéressant en tant que nouvel aliment dans les pays occidentaux, seulement 1 % de la production totale est utilisé comme aliment ou légume, d’après des données fournies par le Cluster mer Bretagne.
Ce marché reste principalement local, avec des producteurs offrant des produits souvent certifiés biologiques et distribués via des circuits courts. Pourtant, les algues suscitent un intérêt particulier en raison de leur potentiel nutritionnel notamment en protéines. Elles sont souvent comparées à d’autres sources de protéines, comme le soja ou l’œuf.
À lire aussi : Haricots, soja, pois, lentilles… profiter des légumineuses sans risques ni inconforts
Par exemple, l’algue verte Ulva, plus connue sous le nom d’ao-nori ou la laitue de mer, est fréquemment consommée comme légume de mer en Asie, présente une teneur en protéines allant de 9 à 32 % du poids sec de l’algue et affiche un équilibre en acides aminés essentiels et non essentiels d’environ 35/65 (soit 35 acides aminés essentiels, pour 65 non essentiels), comparable à celui du soja.
(Les acides aminés sont les éléments de base qui constituent les protéines. Les acides aminés essentiels sont ceux qui ne sont pas synthétisés par l’organisme et doivent être apportés par l’alimentation, NDLR).
Les algues rouges, comme dulse (Palmaria palmata) ou ogo-nori (Gracilaria sp.), se distinguent également par des niveaux de protéines particulièrement élevés (jusqu’à 47 % de la matière sèche). Chez P. palmata, les acides aminés essentiels constituent 36 % de la fraction totale d’acides aminés (avec des teneurs relativement élevées en acides aminés leucine, lysine, phénylalanine et valine).
À lire aussi : Une alimentation à base de protéines végétales est-elle bonne pour la santé ?
Des algues marines qui pâtissent d’un manque de recherche
Cependant, ces algues ont fait l’objet de relativement peu de recherches comparées à d’autres alternatives protéiques telles que les insectes ou les légumineuses.
À lire aussi : Microalgues pour l’alimentation humaine : comment mieux les produire
Ainsi, l’absence de consommation généralisée des algues marines a conduit à un manque de recherche in vivo. La compréhension de la biodisponibilité des composés présents dans les algues reste limitée, ce qui empêche une comparaison précise de la qualité de leurs protéines avec celles d’autres sources protéiques.
Certaines études in vitro ont révélé l’impact des fibres, facteurs anti-nutritionnels sur la digestion des protéines issues des algues. De plus, les caractéristiques détaillées des protéines extraites des algues et leur utilisation potentielle comme ingrédients dans le développement de nouveaux produits alimentaires restent finalement encore peu étudiées.
Enfin, la majorité des recherches se sont concentrées sur la dimension cognitive et très peu sur la dimension émotionnelle, essentielle pour évaluer les perceptions d’un nouveau produit alimentaire.
Un projet d’algues enrichies en protéines pour le CHU de Brest
Le projet PROMALG-Health propose de répondre à ces différents enjeux en proposant de nouvelles sources d’algues Ulva sp., Palmaria palmata et Gracilaria sp. enrichies en protéines.
Cultivées en Bretagne par une entreprise partenaire du projet, les algues seront destinées à la restauration hospitalière du CHU de Brest pour les patients âgés et en long séjour, sous la forme de recettes attractives et créatives imaginées par une entreprise qui commercialise des algues, en collaboration avec l’unité de production culinaire du CHU. La digestibilité des protéines des macroalgues et leurs effets sur la santé à l’aide de modèles pré-cliniques et d’une étude clinique seront évalués en amont par des partenaires de l’INRAE et d’AgroParisTech.
Une évaluation multicritère, environnementale, économique et logistique, de la chaîne alimentaire des protéines de macroalgues, sera également proposée.
Ce projet, porté par un consortium d’universitaires, d’industriels et d’acteurs du secteur de la santé, s’adresse ainsi à toute la filière, de la ferme avec la production de la biomasse jusqu’à l’assiette avec la consommation de produits finis.
Cet article a été co-écrit par Anna Deniel Luque (Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines EMR CNRS 6076 Université Bretagne Sud), Laure Priet (Institut Dupuy de Lôme UMR CNRS 6027 Université Bretagne Sud), Apolline Barbot (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest, Université Bretagne Occidentale), Fatma Ben Brahim (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest, Université Bretagne Occidentale), Nathalie Bourgougnon (Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines EMR CNRS 6076, Université Bretagne Sud) et Audrey Fontaine (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest, Université Bretagne Occidentale).
Le projet PROMALG-HEALTH est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.![]()
France Haliotis, Bord à Bord et Actalia sont partenaires du projet PROMALG-Health.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)





























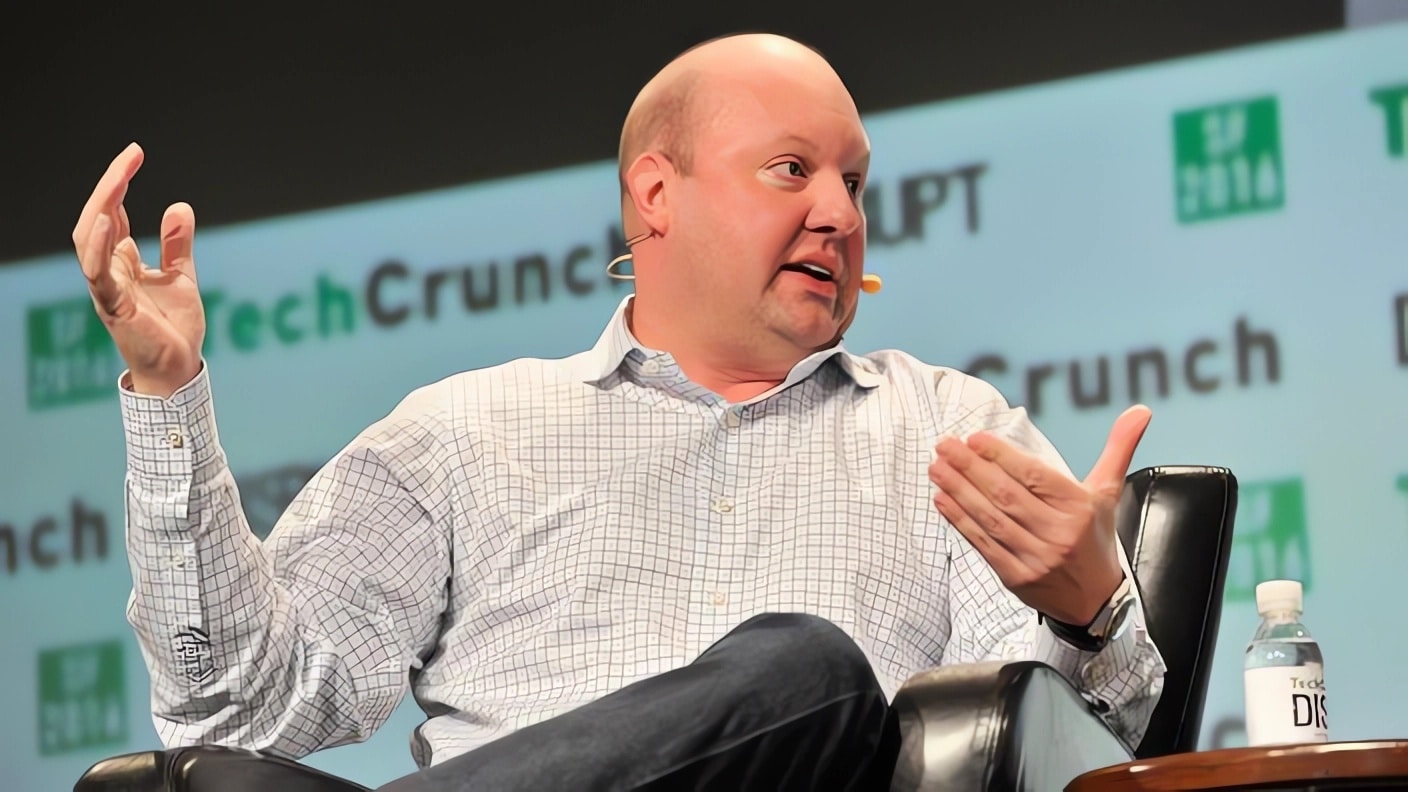
![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)