Judith Godrèche, Adèle Haenel : les médiatisations d’un cri
Dans le procès Ruggia, le traitement médiatique de la parole d’Adele Haenel montre que la colère des femmes doit encore être policée pour être jugée acceptable.

Le jugement dans le procès du réalisateur Christophe Ruggia, accusé d’avoir agressé sexuellement Adèle Haenel lorsqu’elle était mineure, est rendu ce lundi 3 février 2025. Cette actualité est l’occasion de se rappeler que le traitement médiatique des mots de l’actrice a contrasté avec celui accordé à la parole de Judith Godrèche. Et de montrer qu’on impose toujours à la colère des femmes d’être policée pour être jugée acceptable. Analyse de Gaëlle Planchenault, linguiste.
L’année 2024 a vu des femmes se dresser pour dénoncer les violences commises à leur encontre et prendre la parole au nom des autres femmes. Saluant leur courage, les médias les ont appelées des « figures de proue » ou encore des « icônes », utilisant paradoxalement des métaphores qui désignent au sens littéral des sculptures et images par essence muettes. Si on s’intéresse à la manière dont les voix de ces femmes ont été présentées dans les médias, on remarque que le traitement qui leur a été fait est inégal.
Prenons l’exemple de deux femmes qui ont plusieurs fois été à la une en 2024 : Judith Godrèche et Adèle Haenel. Toutes deux actrices, elles ont révélé les actes de violence sexuelle qui les avaient prises pour cible alors qu’elles étaient encore mineures. Ces violences ayant pris place dans le cadre de tournages de films, elles ont dénoncé le silence institutionnel qui les avait contraintes à taire ce qu’elles avaient vécu. Pour mieux comprendre la manière dont les médias ont rapporté leurs discours, on s’arrêtera sur deux moments clés de leur prise de parole, en se concentrant particulièrement sur les médiatisations de deux phrases :
déclarée par Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césars, le 23 février 2024.
prononcée, le 10 décembre 2024, par Adèle Haenel lors du procès de Christophe Ruggia, jugé pour agressions sexuelles aggravées.
La parole rapportée est réappropriée
Les lecteurs des médias ont l’habitude de lire des textes dans lesquels les voix s’entremêlent, la moins visible étant celle du ou de la journaliste. Ils se demandent rarement comment ces voix sont mises en texte. Pourtant, il existe plusieurs manières de rapporter des paroles : la citation directe, le discours indirect ou encore l’insert (celui d’un tweet ou d’une vidéo).
Même si nous avons le sentiment d’accéder directement à ces voix, la parole rapportée est réarticulée, dramatisée : d’une part, parce que le texte médiatique connaît ses règles stylistiques, d’autre part, parce qu’il est contraint à celles du marché de l’attention . Cette réappropriation des paroles par les journalistes donne des clés qui incitent à situer ces voix. Plus problématique est le fait que nous sommes souvent peu conscients du rôle que ces clés jouent dans notre interprétation.
Ces mises en texte dessinent des archétypes qui sollicitent un imaginaire des voix catégorisé selon le genre, la classe sociale, etc. Pour mieux comprendre ce processus, on peut s’intéresser aux verbes choisis pour introduire ces paroles ou aux termes qui servent à les nommer – c’est le travail d’analyse, fait par la linguiste française Jacqueline Authier-Revuz, de ce qu’elle nomme « la représentation du discours autre ».
En parcourant les nombreux articles qui ont rapporté le discours de Judith Godrèche, on lit par exemple que l’actrice « pèse ses mots » (Télérama) et que les autres verbes utilisés pour introduire ses paroles sont « interpeller », « exhorter », « clamer », « marteler » – des verbes qui signalent, non seulement, la force de conviction du propos, mais mettent également l’accent sur sa valeur émotionnelle.
C’est dans ce ton que les publications décrivent un « cri du cœur » (SudRadio.fr), qui retentit à travers un discours « puissant » (les Inrocks, Madame Figaro), « fort » (le HuffPost, le Parisien), « vibrant » (Voici).
Judith Godrèche « interpelle », Adèle Haenel « hurle »
Pour Adèle Haenel, le choix des termes est bien différent : « l’actrice a craqué » (Libération), elle a laissé « exploser sa rage » (France Info), elle « bouillonne » (20 Minutes, le Figaro) et une phrase (sans doute celle de l’AFP) que l’on retrouve systématiquement et avec des variations minimes parue sous ces mots :
C’est la sélection quasi unanime du verbe « hurler » qui interpelle. Avec une origine étymologique qui renvoie à une onomatopée, le terme est généralement utilisé par désigner le cri des animaux (souvent les chiens ou les loups) et dénote le manque d’articulation. On pourrait alors se demander pourquoi les journalistes ne lui ont pas préféré le verbe « crier ». S’agirait-il d’une simple différence d’intensité ? Certes, le discours de Judith Godrèche frappait par la douceur de sa voix.
Cependant, le verbe « hurler » semble coller au personnage construit par les médias depuis une autre cérémonie des Césars, cinq ans plus tôt, alors qu’Adèle Haenel quittait la salle à la remise du prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski, jetant les mots désormais notoires :
« C’est une honte ! »
Là déjà, l’actrice dénonçait l’omerta du milieu du cinéma face à ce que Judith Godrèche appellera plus tard « un trafic illicite de jeunes filles ». Les journaux avaient rapporté sa parole avec une variété de verbes (« prononcer », « lancer », « crier »). Mais le journal qui avait alors choisi celui d’« hurler » était le Figaro – préférant, par ailleurs, au mot « colère » adopté par d’autres journalistes, le terme révélateur de « fureur » dont l’étymologie renvoie à la folie et au délire.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
L’utilité de l’analyse de discours
Pourquoi est-il crucial de s’interroger sur les motifs qui guident ces choix éditoriaux ? Tout d’abord, parce qu’ils ne sont pas simplement stylistiques, mais parce qu’ils contribuent, en renvoyant à un imaginaire des voix, à maintenir des préjugés envers divers groupes. Afin de mieux comprendre comment fonctionne ces préjugés, il faut adopter la lentille de l’intersectionnalité, c’est-à-dire s’interroger sur la conjonction de différents ordres de discrimination, qui sont fonction du sexe, mais aussi de la classe sociale, de l’assignation raciale ou encore de l’orientation sexuelle.
Si nombre d’articles ont mis en parallèle les quêtes de justice des deux actrices, rares sont ceux qui ont ouvertement comparé leurs propos ou leurs personnalités. Toutefois, lorsque la revue Marianne le fait dans un « match » qui vise à découvrir « qui est la plus radicale », il prête Adèle Haenel le rôle de l’« activiste marxiste » et à Judith Godrèche celui de « militante BCBG » et met ainsi en lumière l’assignation à une catégorie sociale qui était sous-entendue ailleurs. La première est ainsi catégorisée, son comportement irrémédiablement associé à une origine – le traitement stylistique de ses propos assumant clairement son classisme.
« Injustice affective »
Dans un article publié dans le New York Times en 2016, l’écrivaine américaine Roxane Gay rappelait que tous les individus n’avaient pas la même possibilité d’exprimer leur colère. Pour expliquer cette inégalité, la philosophe Amia Srinivasan, professeure à l’Université d’Oxford, a conçu le terme d’« injustice affective » – décrivant le phénomène qui contraint les groupes opprimés à taire leur colère, aussi justifiée soit-elle, en exigeant d’eux des stratégies de gestion de leurs émotions. En effet, pèse sur eux la menace que de telles émotions, s’ils ou elles les exprimaient, invalideraient leurs propos.
Les féministes ont ainsi conscience que lorsque les médias représentent la colère d’une femme le soupçon d’hystérie n’est jamais loin et teintera leurs propos quel qu’en soit le contenu (artistique, intellectuel ou politique). Mais cette injustice affective est encore plus vivement ressentie lorsque s’ajoutent d’autres ordres de discriminations (raciales et/ou sociales).
Les suites des deux prises de paroles sont révélatrices. Alors que les deux actrices faisaient allusion à l’impossibilité d’un dialogue, une seule a ressenti le besoin de s’expliquer et de justifier les raisons pour lesquelles elle avait « pété un câble » : Adèle Haenel.
En revenant au discours de Judith Godrèche, on pourra donner ainsi une tout autre fonction au ton qu’elle utilise, à ses mots pesés, à sa voix mesurée. S’il y a bien entendu un style qui lui est propre, il est probable que cette dernière se soit également imposée de contrôler ses émotions afin d’être mieux entendue : de ne pas laisser éclater sa colère de peur que celle-ci n’invalide la justesse de ses paroles.
L’impact des représentations médiatiques
Pour mieux évaluer l’impact de telles représentations médiatiques, il faut s’interroger sur les modèles qu’elles fournissent et le rôle qu’elles jouent dans le conditionnement de ces voix de femmes, et ce, pour commencer de comprendre comment elles différencient les voix acceptables de celles qui seront perçues comme non appropriées.
Une telle lecture critique permet de comprendre le rôle que ces préjugés jouent par exemple dans le manque de diversité des femmes qui prennent publiquement la parole. En effet, au Canada, les statistiques montrent que la proportion des femmes appartenant à des minorités (ethniques, sexuelles et autres) qui ont subi des violences sexuelles est plus large que pour les femmes en général (deux à trois fois plus pour les personnes trans et non binaires) : une situation qui est sans doute similaire en France même si les chiffres manquent (les statistiques y sont contraintes par la loi Informatique et Liberté).
Pourtant les paroles de ces femmes restent peu audibles et il est probable que nombre d’entre elles préfèrent se taire de peur de voir leurs voix réappropriées, leurs propos décrédibilisés. Enfin, il faudra se demander pourquoi celles qui parlent s’imposent un calme disproportionné face à l’intensité de la violence subie et de la vindicte qui continue d’être exercée à leur encontre.
Il est temps que les médias reconnaissent la légitimité de ces colères, l’humanité de ces émotions – et rendent ainsi à ces femmes toute leur dignité.![]()
Gaelle Planchenault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)





























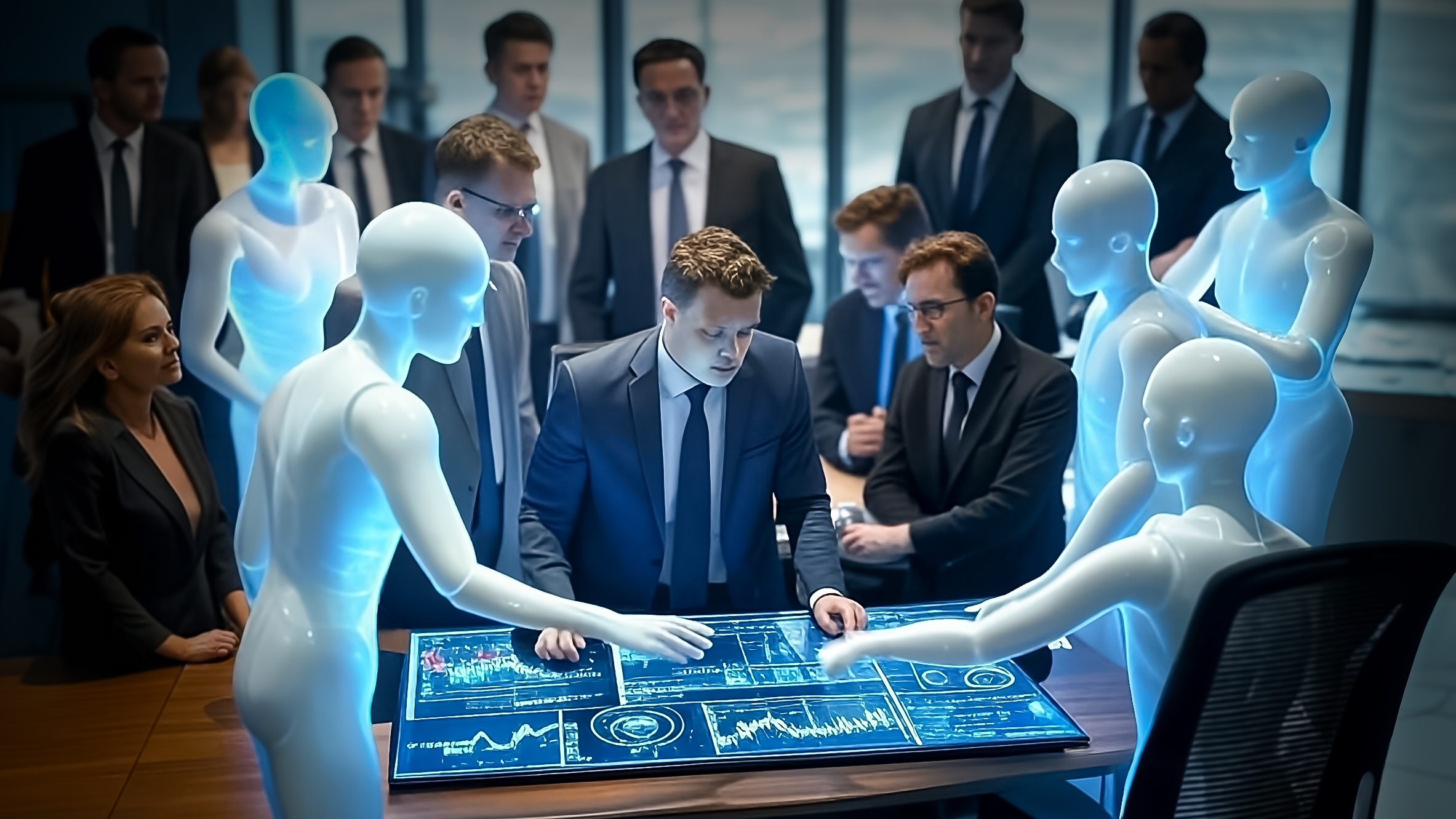
![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)