Croissance et développement, nouvelles perspectives
Un ouvrage iconoclaste, qui dresse un panorama actuel de la réflexion sur la croissance et le développement. A travers une perspective et une vision originales, tournées vers l’action. Bernard Landais a été l’un de mes professeurs lorsque j’étudiais à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest à la fin des années des années 1980 et début […]
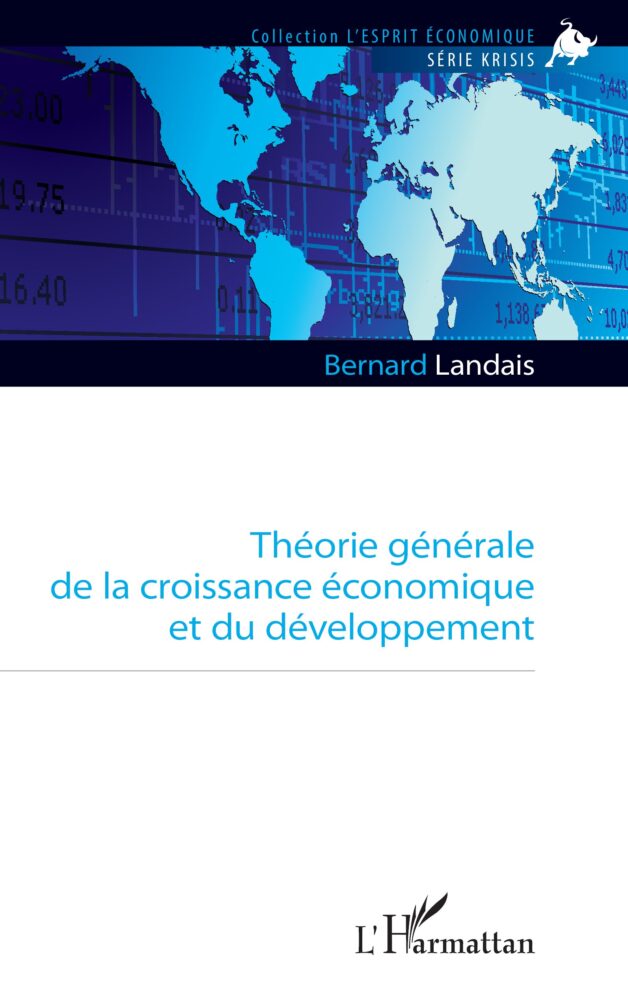
Un ouvrage iconoclaste, qui dresse un panorama actuel de la réflexion sur la croissance et le développement. A travers une perspective et une vision originales, tournées vers l’action.
Bernard Landais a été l’un de mes professeurs lorsque j’étudiais à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest à la fin des années des années 1980 et début 1990. J’ai bénéficié de ses enseignements de qualité sur les politiques économiques, lu un ou deux ouvrages de référence sur ce thème parmi ceux qu’il avait conseillés à l’époque, ainsi que son livre sur le monétarisme, paru en 1987.
Je découvre avec plaisir qu’il a, depuis, sorti plusieurs ouvrages et poursuit avec résolution, puisque le livre que nous allons présenter ici vient tout juste de paraître. Plein de panache et de caractère, alliant connaissance et rigueur intellectuelle.
Une analyse critique hors des sentiers battus
Ainsi qu’il l’annonce lui-même dès l’avant-propos, Bernard Landais n’entend pas présenter un nième ouvrage universitaire sur les théories de la croissance. Ni élaborer une sorte de synthèse de toutes les grandes théories passées et présentes.
Sa volonté est au contraire de tenter de dépoussiérer une discipline inutilement alourdie selon lui par un amas de théories dont les enseignants se sentent trop souvent obligés d’en présenter une synthèse faite de juxtapositions et d’empilements, devenue au fil du temps trop chargée et en bonne partie obsolète car pétrie de contradictions et d’un manque de remises en causes, pourtant salutaires.
Son ambition est de proposer une nouvelle théorie générale de la croissance économique, exempte de toutes ces scories et faux problèmes ou problèmes mal posés qu’une saturation de travaux statistiques et économétriques sont encore venus renforcer au détriment de toute cohésion, et ce d’autant plus que tout n’est pas chiffrable ou ne peut se réduire à des statistiques. Une nouvelle théorie qui se veut à la fois utile et crédible, mais aussi davantage opérationnelle. Loin des modes du moment en matière de travaux de recherche théoriques ou appliqués.
L’idée est également et surtout de mettre en lumière, en les étudiant, les interactions nombreuses et bidirectionnelles entre développement et croissance économiques, selon lui indissociables. En les élargissant aux facteurs humains et en insistant notamment sur l’importance des cultures dans l’analyse.
Ne pas négliger les apports des théories du développement
C’est donc à une critique de la théorie dominante de la croissance que Bernard Landais se livre, la qualifiant d’excessivement simpliste sur le plan de la formalisation des modèles économétriques face à la complexité du réel et au poids de l’incertitude.
Et c’est là le sujet central de l’ouvrage : trop de facteurs impalpables sont ignorés, par souci de simplifier. En particulier ceux liés aux apports de la théorie du développement, très souvent complètement occultée.
Pour fonder son raisonnement, il se base fonde sur le modèle de croissance à investissement effectif (MIE), combinaison de cinq facteurs : celui d’organisation juridique et gestionnaire de la production Op (agrégat nouveau dans les travaux sur la croissance et absolument majeur), le travail, le capital physique, le capital humain professionnel et les procédés technologiques disponibles.
Tout en soulignant le problème de l’imprécision des mesures du PIB, trop systématiquement éludé. Qui en fait un indicateur artificiel et dont la mesure apparaît parfois en contradiction avec la réalité vécue, du fait justement de la dissociation avec les théories du développement et de la non-prise en compte de facteurs aussi importants que l’évolution du bien-être ou de l’utilité.
Pour des raisons notamment de longueur, mais aussi de compréhension fine de ces mécanismes complexes, je renvoie bien sûr au livre pour comprendre le détail de chacun de ces facteurs et la manière dont fonctionne leur combinaison.
Mais si l’on considère simplement le premier facteur cité – Op – précisons rapidement qu’il s’agit à la fois des institutions, des lois, des règlements, des directives, des pratiques de gestion, dans de multiples domaines et dimensions, de portée aussi bien locale que nationale ou internationale, ainsi que des systèmes d’incitations sous toutes leurs formes, jusqu’à l’intégration du caractère plus ou moins libéral ou socialiste de l’économie considérée.
On perçoit bien ici que les pratiques politiques, administratives, publiques et privées, de même que l’influence des lobbies, de la corruption, et d’un tas d’autres niveaux ou acteurs que je ne peux tous énumérer, jouent un rôle jusque-là sous-estimé et pourtant crucial dans la croissance et le développement. Ce qui montre bien la portée des analyses et l’urgence qu’il y a à reconsidérer les approches traditionnelles. Qui pêchent par ailleurs aussi par leurs mesures trop exclusivement quantitatives, au détriment des dimensions qualitatives pourtant primordiales.
En outre, ce modèle de croissance à investissement effectif intègre insuffisamment la dynamique de croissance. Ce qui conduit Bernard Landais à prolonger les analyses et à y intégrer de nouveaux éléments. Tels que les anticipations, les déséquilibres ou les crises, mais aussi l’évolution des mentalités par exemple, ou encore dans certains cas les composantes géopolitiques.
Pour s’acheminer ensuite vers la dynamique de croissance de très long terme.
Mais les facteurs sont nombreux, et le détail des explications assez technique, donc je renvoie là encore à l’ouvrage.
Une théorie culturelle de la croissance
De fait, la théorie standard reposait quasi-exclusivement sur la fonction de production. Non seulement le modèle MIE y introduit les dimensions liées aux différentes formes d’investissement, dans une perspective dynamique, les politiques de l’offre, l’incidence de la fiscalité, du système économique en vigueur, et beaucoup d’autres paramètres, mais le véritable apport à ce modèle, qui vient le prolonger, est celui de la théorie culturelle de la croissance. A laquelle Bernard Landais consacre son troisième chapitre.
Se fondant à titre d’illustration, mais non sans un regard critique, sur les travaux de David Weill, il y décrit les liens essentiels en matière de prospérité, entre croissance et de multiples facteurs fondamentaux tels que les harmonies économiques, les relations de confiance, bien sûr l’éducation, la santé, ou même la capacité sociale, le goût de l’effort ou l’arbitrage travail-loisir, la culture scientifique, entrepreneuriale, professionnelle, de liberté, ou au contraire de conformisme, la puissance politique, de manière générale les mentalités, l’art de vivre, la complaisance, la sûreté, etc. Les facteurs sont très nombreux, et surtout se renouvellent. La culture d’un pays est en effet évolutive, et non figée dans le temps. Elle est susceptible d’évoluer dans un sens favorable ou défavorable à la croissance à long terme. Autrement dit, les interactions nombreuses entre ces différentes formes de culture contribuent à ce que l’on appelle le développement. Même la démographie et les migrations auront une incidence (un encadré de plusieurs pages en développe l’esprit).
De plus, point essentiel, le choix du système économique y joue un rôle fondamental. Ces formes de culture et leurs interactions ne seront en effet pas du tout les mêmes selon que l’on évolue dans un système plus ou moins libéral ou plus ou moins socialiste. Par exemple, « le système libéral est celui qui laisse libre cours à l’accumulation et à la répartition libres du capital humain ». Ce qui est propice notamment à la créativité.
Une théorie du développement
Le développement a un impact primordial sur la croissance. Plus que l’inverse, précise Bernard Landais, qui déplore la relégation des travaux sur le développement, à proportion qu’ils sont passés de mode et peu valorisants en termes de recherche aujourd’hui. Pourtant, son importance est primordiale. Il en va du progrès ou du recul d’une société, fondé en bonne partie sur son système de valeurs. C’est lui qui détermine l’utilité et le bonheur des individus.
Dans la dernière partie de l’ouvrage, il nous propose ainsi un modèle complet intégrant toutes les variables précédentes et leurs interactions, dont le dessein est d’ouvrir la voie à un grand champ de recherches empiriques. Fondé, autant que possible, sur une politique de l’offre élargie aux variables immatérielles. Et une conception moins mécaniste et simpliste de la science économique, s’imprégnant davantage des réalités humaines et de leur extrême diversité (à cet égard, Bernard Landais rend hommage à Michel Biays, Professeur à l’Université de Rennes, dont j’ai également le souvenir des cours vivants et passionnants dont j’ai pu bénéficier) que ne le font les démarches quantitatives stéréotypées, souvent fondées sur les préjugés et le manque d’anticipation.
Avec l’idée toujours que l’économétrie doit y être subordonnée, et non prévaloir. Elle doit servir les anticipations en s’appuyant sur les enquêtes économiques, psycho-sociologiques, statistiques, historiques. En calibrant également mieux la position des Etats et des systèmes économiques les uns par rapport aux autres. En évitant notamment à nos dirigeants de pervertir les fruits des libertés individuelles par des actions politiques reposant sur de bonnes intentions trop souvent viciées et de céder trop facilement aux groupes de pression multiples.
Bernard Landais, Théorie générale de la croissance économique et du développement, L’Harmattan, juillet 2024, 198 pages.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)






























![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)